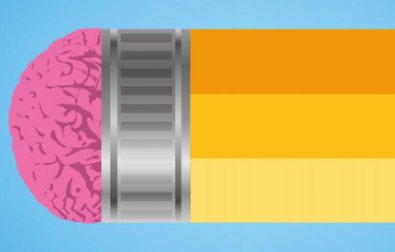La banlieue est “un village où tout le monde se connaît, où il y a des crapules, où il y a des menteurs, où il y a des gens gentils, où il y a des gens méchants, où il y a des histoires qui se transmettent, où il y a des malheurs, des joies, mais tout est un village”, me dit Rachid Laïreche, journaliste à Libération, à la table d'un bistrot du treizième arrondissement de Paris. Originaire de Montreuil, une commune de Seine-Saint-Denis à l'est de Paris, il est l'auteur, avec Ramsès Kefi, de Le Retour du roi Jibril. Les contes de la cité (éditions L'Iconoclaste, 2025), un livre qui a pour toile de fond les banlieues. “Un village”, ajoute-t-il, “où il y a plus de pauvres qu'ailleurs”.
Le mot “banlieue” évoque, en France et ailleurs, un imaginaire dense et chargé. Dense en stéréotypes, chargé de questions – sur la pauvreté, le chômage, la criminalité, l'histoire coloniale et postcoloniale. Trop de problèmes pour pas assez de solutions : ces régions “marginales” souffrent d’un manque de données et d’un éloignement géographique et politique, mis à distance des centres-villes comme des dynamiques de pouvoir et des décisions.
Malgré leur relative proximité avec le “centre”, ces territoires concentrent de grandes inégalités : économiques, sociales et environnementales, ainsi qu'une culture propre au territoire et à son histoire.
En France, bon nombre de ces contradictions se concentrent en Seine-Saint-Denis, le “neuf-trois”, comme on l’appelle également – référence populaire à son numéro de département, le 93. Partie de la région Île-de-France, c’est le département le plus pauvre de la France métropolitaine : 1,7 million de personnes y vivent, dont 27,6 % sous le seuil de pauvreté (contre une moyenne nationale de 15,4 %, en augmentation).
“Le fait que ce soit des quartiers précaires, pauvres, ça dit plein de choses”, explique Héléna Berkaoui, journaliste et rédactrice en chef du Bondy Blog, un journal en ligne créé à la suite des émeutes des banlieues de 2005. “Mais ça dit aussi qu'il y a des dynamiques sociales qui sont très fortes. Il y a des dynamiques de subsistance, des liens sociaux qui sont extrêmement importants entre les habitants”.
Il y a 20 ans éclataient les émeutes de 2005 après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, deux adolescents qui se cachaient par peur (et uniquement par peur) d'un contrôle de police à Clichy-sous-Bois, toujours en Seine-Saint-Denis. Depuis, le Bondy Blog s'efforce de repenser la représentation des quartiers populaires, mais aussi la manière dont l'information est produite.
| La Seine-Saint-Denis, département des extrêmes |
| La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France métropolitaine (42 % des habitants ont moins de 30 ans) et, comme le rapporte Le Monde, tout y manque : il y a moins d'enseignants, moins de policiers, moins de magistrats, moins de médecins (49,8 médecins généralistes pour 100 000 habitants contre une moyenne nationale de 83,5). Et puis il y a la question écologique : “Dans ce département de l'Île-de-France, qui compte cinq établissements classés Seveso (c’est-à-dire des bâtiments posant des “risques d’accidents majeurs”), il y a déjà nombre d’incinérateurs, de datacenters, d’axes autoroutiers et d’infrastructures polluantes. Et les habitants – dont les deux tiers sont des immigrés de première et deuxième génération, souvent postcoloniaux – sont parmi les plus exposés à la pollution des sols, aux fortes chaleurs, à l’absence d’espaces verts et à la précarité énergétique”, rapporte le magazine Socialter. “La Seine-Saint-Denis offre un visage contrasté [...], c'est le département qui présente les indicateurs qui traduisent une demande sociale hors norme en Île-de-France, mais également en France métropolitaine”, explique Raymond Lehman, coauteur d'une étude reprenant les données sociodémographiques de l'Insee. “Le taux de chômage y est de 17,1 %, contre 12 % en France”. Mais c'est aussi l'un des départements les plus dynamiques sur le plan économique. C'est, selon Lehman, le “troisième département d'Île-de-France (la région en compte quatre) en nombre d'emplois (plus de 605 000 en 2021)” et celui où le nombre d'emplois a le plus augmenté. “On observe une dynamique économique remarquable depuis le début des années 2000 en Seine-Saint-Denis. Le nombre d'emplois y a fortement augmenté [et] de nombreux grands groupes ont ouvert ou transféré des établissements sur le territoire départemental (BNP, SNCF, VEOLIA, ADP, GENERALI, SIEMENS, EDF, etc.), sans compter les grands établissements publics”, poursuit-il. Mais les habitants n'en voient guère les bénéfices : “Le taux de chômage ne baisse pas”, confirme Lehman. |
La Seine-Saint-Denis abrite plusieurs villes plus ou moins connues, parmi lesquelles Saint-Denis même, Montreuil, Saint-Ouen et Aubervilliers. Cette dernière – où, pour être tout à fait transparente, je vis – est emblématique des dynamiques à l'œuvre dans le département.
Aubervilliers
Didier Hernoux et Bernard Orantin m'accueillent au siège de leur association, la Société de l'Histoire et de la Vie à Aubervilliers, à quelques pas du siège de cette commune, qui est l'une des plus grandes de Seine-Saint-Denis (90 000 habitants) et classée sixième ville la plus pauvre de France (taux de pauvreté de 41 % et taux de chômage de 22 %).
Autrefois, m'explique-t-on, Aubervilliers était un “bourg agricole qui nourrissait Paris”, avant de devenir une ville industrielle. Aujourd'hui, elle connaît une dynamique de post-industrialisation et de tertiarisation de l'économie commune à de nombreuses villes de la banlieue parisienne.

Le siège de l'association trahit le passé agricole d’Aubervilliers : une petite maison à deux étages avec, à l'arrière, ce qui était autrefois le corps de ferme. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la ville a connu une croissance exponentielle et a été le théâtre de plusieurs vagues migratoires, d'abord européennes (Polonais, Italiens, Portugais, Espagnols), puis postcoloniales. “Lentement, la désindustrialisation est venue pour aboutir à ce qu’on voit aujourd'hui : du béton qui pousse de partout”, me raconte Hernoux en esquissant un sourire.
Une allusion au nombre de chantiers qui poussent comme des champignons – rien qu'autour du siège de l'association, j'en ai compté cinq – sans oublier celui, immense, qui occupe et bloque la place de la Mairie. Après avoir accueilli le prolongement de la ligne 12 du métro, elle abrite aujourd'hui le chantier de la ligne 15, une partie intégrante du “Grand Paris”, un projet de développement qui reliera les trois départements qui entourent Paris grâce à 200 km de voies et 68 stations, pour un coût estimé à 32,5 milliards d'euros.

Hernoux et Orantin analysent ce déclin industriel, similaire à celui d'autres villes de Seine-Saint-Denis : “Les emplois, il y en a encore beaucoup, mais c’est du tertiaire, ce ne sont pas les mêmes personnes”.
“Maintenant, il y a des gens qui arrivent [à Aubervilliers] à cause de la promotion immobilière qui est galopante, [...] mais qui, pour la plupart, n’ont pas vraiment d’attache avec la ville”, ajoutent-ils. La dynamique est celle que connaissent de nombreuses villes en périphérie des grands centres : de nouvelles populations apparaissent, attirées par la proximité avec la capitale, les liaisons rapides avec celle-ci et des coûts relativement plus bas – dans le cas d'Aubervilliers, parfois proches de la moitié du coût au mètre carré à Paris – mais sans s'intéresser à la ville dans laquelle elles s'installent.

Le risque ? Qu'Aubervilliers devienne “une ville-dortoir”. Mais pour Hernoux et Orantin, la situation relève de “choix politiques” : “Soit on décide que c’est une ville-dortoir [...], soit on décide qu’on développe l’emploi et l’habitat”.
L'histoire du logement social est l'histoire de la France
Sébastien Radouan est historien, professeur d'histoire et de cultures architecturales pendant huit ans en école d'architecture. Il œuvre aujourd'hui en tant que médiateur scientifique pour l'AMuLoP (Association pour un Musée du Logement Populaire).

“Nous travaillons avec des personnes qui ont réellement vécu dans le quartier. C'est une approche qui peut surprendre : beaucoup de gens ne pensent pas que leur histoire soit importante”, mais à travers ces récits, explique-t-il en m’accueillant au siège de l'association, “nous racontons l'histoire de la société française”. L'AMuLoP s’est établie dans un appartement de la cité Emile-Dubois. Dans ses locaux, elle reproduit occasionnellement des vrais logements en se basant sur la vie des personnes ayant réellement habité le bâtiment, afin de donner à voir les existences diverses du lieu.
Racontez ce que signifie vivre dans un quartier populaire permet de poser les questions relatives au travail, au logement, à la culture de l'habitat, à la mobilité ou aux migrations, et aide à comprendre ce que représentent les logements sociaux dans le parcours des familles.
La cité Emile-Dubois est ce qu’on appelle un “grand ensemble” – un grand quartier de logements sociaux. Jadis, la “Cité des 800” en abritait 796. Aujourd'hui, la moitié seulement a survécu aux démolitions. Nous sommes à la station de métro Fort d'Aubervilliers, où un autre chantier imposant de la ligne 15 s'étend vers un nouvel éco-quartier récemment construit.

À terme, la majeure partie de la cité Emile-Dubois sera remplacée par des logements privés, deux fois plus que les logements sociaux qu’elle abrite aujourd’hui, m’explique Radouan pendant notre déjeuner. Les habitants sont soit en cours de relogement, soit ont déjà été réinstallés dans les nouveaux logements sociaux qui ont été construits – avec souvent un loyer plus élevé, vu qu’il s’agit de nouveaux immeubles. Certains sont satisfaits du changement, me dit-il.
D'autres, moins. Pour certains des habitants avec lesquels l’association a travaillé, “le processus de démolition déclenche plusieurs choses”, notamment un “besoin que quelque chose survive”. Il peut être en effet très douloureux de voir un bâtiment se dégrader (si celui-ci est voué à la démolition, les propriétaires et locataires choisissent parfois de ne jamais effectuer de réparations). D'autres se demandent “pourquoi détruire une structure qui est solide au lieu de la réparer”.

Cette politique de rénovation urbaine lancée en 2003 a ensuite donné naissance à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le but de sortir de la logique des “grands ensembles” et de “refaire la ville”. L’ambition est de créer la “mixité sociale” dans les quartiers où la concentration de logements sociaux est forte afin d’attirer les classes sociales plus aisées (par exemple en construisant pour vendre à des particuliers) et ainsi permettre une “mixité économique” – qui finit par se transformer en gentrification.

Ces interventions concernent les logements sociaux ou privés (visés pour destruction ou rénovation) et les infrastructures publiques. L'ANRU, qui a pour objectif d'améliorer les conditions de logement et de vie, s'occupe des quartiers “listés par la loi comme ‘prioritaires’ car concentrant un fort taux de pauvreté”, m'explique par e-mail Thibaut Prévost, porte-parole de l'ANRU.
Démolir ces grandes unités immobilières signifie rompre avec l'urbanisme des “grands ensembles”, un modèle fortement critiqué depuis longtemps car “considéré comme monotone, répétitif et déshumanisant”, explique Radouan. Mais, ajoute-t-il, “toute forme de construction génère une culture”. Et ceux-ci ont produit une “culture urbaine qui est en train de disparaître, qu’on est en train de détruire”.
“C’est inéluctable qu’une ville comme Paris s’agrandisse, mais ce n’est pas fait avec les pauvres, c’est fait contre les pauvres” – Héléna Berkaoui
Il s'agit, m'explique-t-il, de structures “qui ont compté dans l'histoire urbaine, qui ont permis à une grande partie de la population française d'accéder à de meilleurs services et dont la construction est pensée avec intelligence, tant dans l'utilisation que dans l'économie des matériaux”.
Nous assistons à une forme de “destruction des cultures, de pratiques sociales”, regrette Sébastien Radouan, “nous devrions être beaucoup plus attentifs aux histoires familiales, à l'environnement, à ce qui existe”. Après avoir détruit 360 logements sociaux, on en construit bien ailleurs. Mais “il s'agit de 360 logements sociaux à la sortie du métro”, donc reliés au reste de la ville et de la région.
Gentrification ou mixité sociale ?
“C’est important d’entendre qu'il y a aussi des départs qui sont contraints parce que le prix de l’immobilier est devenu trop cher ou parce qu'il y a eu des plans de rénovation urbaine qui ont forcé les gens à partir”, m'explique Héléna Berkaoui du Bondy Blog en parlant de la Seine-Saint-Denis. “Et dans un quartier, ce n'est pas anodin”.
Les Jeux olympiques de Paris en 2024, dont le département a également été le théâtre, a entraîné la construction de grands ouvrages (piscines, installations sportives, logements) qui ont contribué à redessiner en partie le territoire. “Je ne sais pas si nous serons les premiers à bénéficier des avantages du Grand Paris”, admet Berkaoui à propos du projet de création de la région métropolitaine qui comprend la capitale et les départements environnants. “C’est inéluctable qu'une ville comme Paris s’agrandisse, mais ce n’est pas fait avec les pauvres, c’est fait contre les pauvres”.
Le livre Les naufragés du Grand Paris Express (éditions La Découverte, 2024) raconte le parcours de celles et ceux qui vivent la démolition des logements sociaux, reconstruits plus loin et plus chers, tandis que les prix des logements augmentent dans le secteur privé. Dans une interview accordée à Street Press, la sociologue Anne Clerval , co-autrice de l’ouvrage, explique : “On explique à tort les difficultés sociales des quartiers populaires par la concentration géographique des classes populaires [...]. La mixité sociale n’est rien d’autre qu’un projet de les disperser dans l’espace, ce qui ne réglera rien, au contraire”.
La fierté et la conscience d'une culture sont des thèmes qui reviennent dans la discussion avec Héléna Berkaoui. “Il s'agit de populations [...] issues de l'immigration postcoloniale qui ont donc un rapport très particulier à ces quartiers”, relate-t-elle. “Au départ les immigrés [...] pensaient repartir, mais ils sont finalement restés”. Ce “conflit d'identité” donne au quartier une valeur supérieure. Si l’on se réfère au rap ou à la culture urbaine, on “remarque assez facilement qu'il y a une fierté” à l'égard du lieu, poursuit Berkaoui. Il s'agit, selon elle, d'une forme de “retournement du stigmate”.

Quel stigmate ? Celui de subir le discours voyant dans les banlieues des “quartiers urbains connus pour être malfamés, pauvres et stigmatisés dans les médias”.
“Les plans d'urbanisme ne tiennent pas compte [des liens entre habitants]”, regrette Berkaoui. “Puisqu’on va dire que c’est des liens officieux, c'est de l’entraide, mais c’est pas formalisé, donc c’est pas pris en compte dans les plans de rénovation”, explique Berkaoui.
Dans la manière de “penser la ville, la gentrification, ça dit vraiment quelque chose”, conclut-elle. Elle témoigne du “désintérêt qu’on a pour les populations qui sont installées dans ces quartiers-là”, mais aussi de “la crise du logement, qui n'est pas du tout régulée par l’Etat”, et, par là, du “capitalisme carnivore qui maltraite énormément les gens, notamment les plus pauvres qui cherchent à se loger”.
🤝 Cet article a été réalisé dans le cadre du projet PULSE, au sein d'une série sur les “zones périphériques” en Europe, en collaboration avec Il Sole 24 Ore, OBCT (Italie) et El Confidencial (Espagne).
O
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !