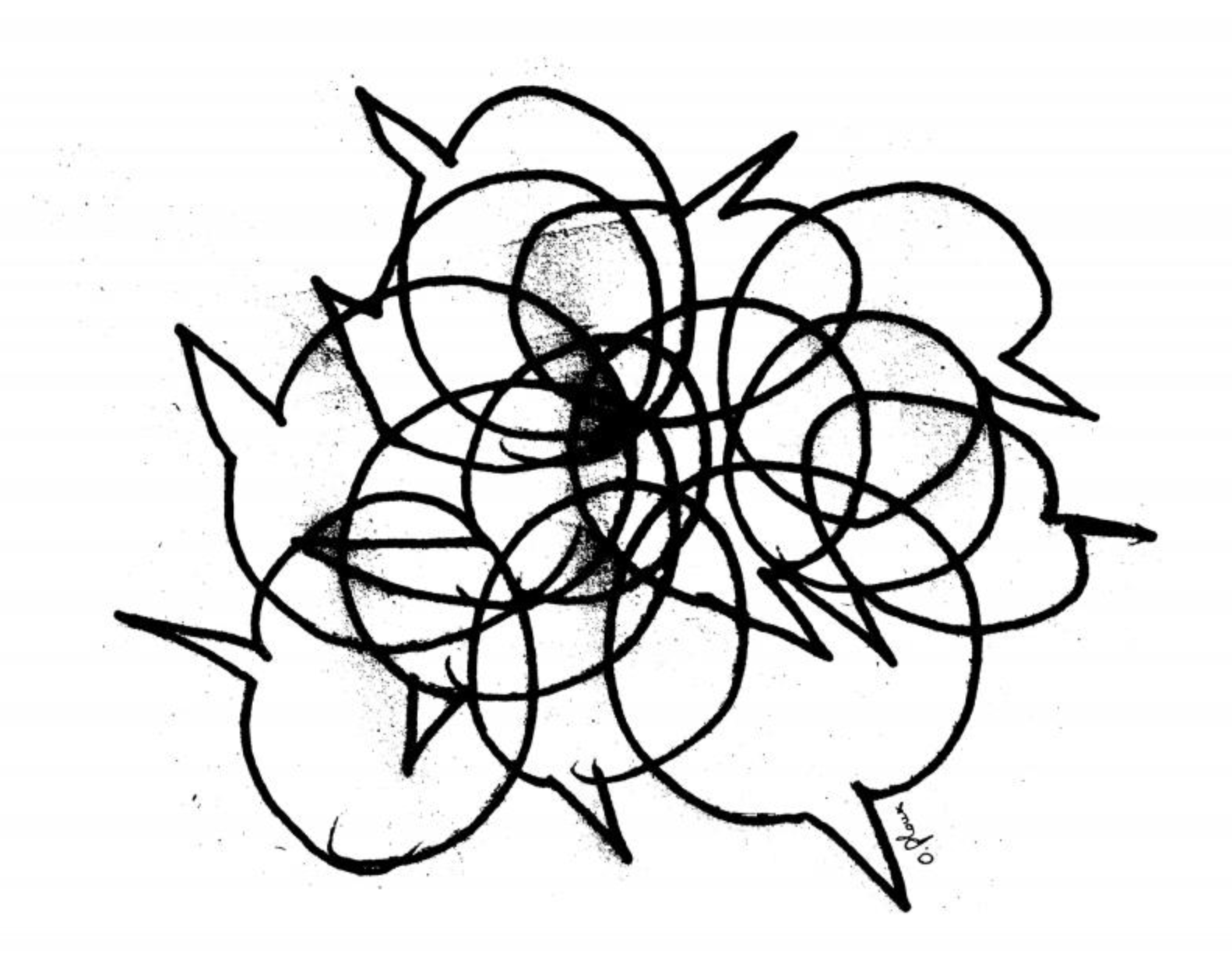Alors qu’à l’heure où nous écrivons la Belgique et la France se cherchent toujours un gouvernement – une quête compliquée par le souhait d’en exclure des partis d’extrême droite ayant progressé dans les urnes – certains de leur voisins ont franchi le pas, et accueilli dans leur exécutif des formations de la droite radicale.
“La Finlande, l’Italie et la Slovaquie ont été rejoints par deux autres pays de l’UE dont les gouvernements présentent des partis extrémistes ostracisés jusqu’il y a peu”, note ainsi Petr Jedlička dans Deník Referendum. En Croatie, “il s’agit du troisième gouvernement consécutif mené par le parti traditionnel de la droite nationaliste mais pro-occidentale HDZ”, dans lequel fait son entrée pour la première fois le Mouvement patriotique (DP, extrême droite), écrit encore Jedlička.
Aux Pays-Bas, il a fallu pas moins de 223 jours pour que, le 2 juillet, voit le jour le gouvernement mené par l’ancien chef du renseignement Dick Schoofs. Sans affiliation politique, il dirige pourtant l’exécutif le plus à droite de l’histoire récente du pays, note Politico. Les débuts du gouvernement Schoofs ont été marqués par des tensions entre les partis de la coalition, note Dieuwertje Kuipers dans Vrij Nederland, notamment en raison des piques et critiques lancées par Geert Wilders, le chef de file du Parti pour la liberté (PVV, extrême droite) arrivé en tête aux élections législatives de 2023, à l’encontre de ses partenaires, et d’un certain malaise de ces derniers vis-à-vis de ses déclarations les plus outrancières.
Profitant de la liberté que lui donne son “simple” mandat de député, Wilders donne la désagréable impression de marquer Schoofs à la culotte par X (ex-Twitter) interposé, et de vouloir imposer ses vues à toute la coalition. Il n’est dès lors pas étonnant, observe encore Kuipers, que “de nombreux électeurs s’attendent à ce que l’exécutif tombe prématurément en raison des différences de vues”.
Ce n’est probablement pas un hasard si Wilders choisit le réseau social le plus clivant pour aiguillonner le gouvernement : depuis son rachat par le magnat américano-canado-sud-africain Elon Musk il y a deux ans, la première véritable agora globale s’est transformée en une arène où les discours haineux ou conspirationnistes ainsi que les bots d’extrême droite prolifèrent. “X était autrefois décrit comme une ‘place publique planétaire’ où les journalistes, les politiques et les citoyens intéressés pouvaient se réunir pour débattre publiquement. Mais vu le nombre de journalistes, d'universitaires et d'utilisateurs de gauche qui l'ont quitté, il semble peu probable qu'il redevienne ce qu'il était”, regrette Katherine M. FitzGerald dans The Conversation.
Au nom de la liberté d’expression sans entraves, le propriétaire de Tesla et SpaceX a en effet promu des profils controversés ou réadmis personnalités qui avaient été bannies de la plateforme par la précédente gouvernance. Il n’hésite pas à violer les règles d’usage de la plateforme en partageant de fausses informations et des deepfakes – des vidéos réalisées par l’intelligence artificielle mettant en scène des personnalités réelles. Lorsque l’homme le plus riche du monde s’empare du plus grand mégaphone digital, les conséquences ne peuvent se cantonner à la seule liberté d’expression.
Nous avons pu le constater encore une fois cet été, avec les émeutes anti-immigrés qui ont éclaté dans plusieurs villes du Royaume-Uni après que des rumeurs selon lesquelles l’auteur du meurtre à coups de couteau de trois enfants dans un cours de danse à Southport (dans le nord-ouest de l’Angleterre) était un demandeur d’asile musulman (l’auteur présumé est un ressortissant britannique né de parents rwandais) ont circulé, amplifiées par des “influenceurs” proches de la droite radicale, tels que Stephen Yaxley-Lennon (mieux connu sous le nom de Tommy Robinson) ou Andrew Tate.
Tous deux d’ailleurs sortis du bannissement par Musk, qui a ajouté son bidon d’huile sur le feu en assurant avec expertise que “la guerre civile [était] inévitable” au Royaume-Uni, ce qui lui a valu d’être qualifié de “pyromane avec une boîte d’allumettes à la main” par Alan Rusbridger dans le quotidien britannique The Independent. Le rédacteur en chef de Prospect fustige dans son magazine “la manière dont Twitter/X est gérée – ou pas” et “dont elle est utilisée pour fomenter la haine, si ce n’est la violence bien réelle ; et, peut-être plus important, pour éroder toute idée que certaines choses sont vraies et vérifiables, et d’autres pas”. Rusbridger cite l’essai The Constitution of Knowledge (“La Constitution du savoir”, Brookings Institution Press, 2021, non traduit en français) de l’écrivain américain Jonathan Rauch, dans lequel ce dernier “énumère les quatre domaines dont les activités permettent à la plupart d'entre nous de vivre dans une communauté fondée sur la réalité : la science et l'université, le journalisme, le droit et l’Etat”.
Or, note Rusbridger, “pour échapper à cette réalité, vous commencez par attaquer les scientifiques, les avocats, les journalistes et le ‘marais’ ou la ‘bulle’ de l’Etat. Puis vous allez plus loin. […] Il a fallu des siècles de travail conscient pour construire la constitution de la connaissance afin, comme le dit Rauch, de ‘nous sauver de nous-mêmes’. Les réseaux sociaux sans entraves font le contraire et mènent à un monde dans lequel, comme le montrent de nombreuses enquêtes, nous ne savons progressivement plus qui, ou quoi, croire”.
“Cet été, nous avons assisté à quelque chose d'inédit”, note dans The Guardian Carole Cadwalladr : “Le milliardaire propriétaire d'une plateforme technologique a affronté publiquement un dirigeant élu [le Premier ministre Keir Starmer] et a utilisé sa plateforme pour saper son autorité et inciter à la violence. Les émeutes de l'été 2024 en Angleterre ont été le ballon d'essai d'Elon Musk” en vue de l’élection présidentielle américaine de novembre. “Il s'en est tiré à bon compte”, ajoute la spécialiste de l’extrême droite et des réseaux sociaux, “et si vous n'êtes pas terrifiés par l'extraordinaire pouvoir supranational que cela représente et par les conséquences potentielles, vous devriez l'être.”
D’autant que ces plateformes semblent s’affranchir de plus en plus des règles et des garde-fous, tout en continuant à prôner l’auto-régulation : “Twitter, devenu X, a licencié au moins la moitié de son équipe chargée de la transparence et de la sécurité. […] Des milliers d'employés chargés de détecter les fausses informations ont été licenciés par Meta, TikTok, Snap et Discord [alors que] Facebook a mis fin à l'un de ses derniers outils de transparence, CrowdTangle”.
Face à un tel déferlement, la réponse des autorités en Europe est pour le moins faible, et illustre bien l’asymétrie du rapport de force actuel entre pouvoirs publics et plateformes numériques : le mois dernier, le commissaire européen pour le Marché intérieur et les services, Thierry Breton, avait envoyé une lettre à Elon Musk pour lui rappeler qu’en tant que patron de X, il avait l’obligation légale d’empêcher “l’amplification des contenus nocifs” au regard des lois européennes. Ce à quoi l’homme le plus riche de la planète a répondu par un “meme” dont le ton illustre son concept de liberté d’expression et de sa vision de l’agora globale. Ça promet.
Si X semble servir surtout les intérêts de l’extrême droite, Telegram paraît politiquement plus neutre, mais non moins toxique. Arrêté récemment à Paris, son cofondateur, Pavel Durov, a en effet, pour autant que l’on sache, toujours refusé d’intervenir dans la promotion ou le blocage des comptes hébergés sur sa messagerie. Si Telegram a fourni une alternative à Internet dans les pays où la liberté de la presse est attaquée par les autorités – à commencer par la Russie – il est tout autant apprécié par des pro-Kremlin de tous bords que par des opposants russes.
“Le mélange d'utilisateurs sans intermédiaire, y compris deux armées en guerre, reflète précisément l'idée que se fait Durov de la liberté d'expression”, observent ainsi Andreï Soldatov et Irina Borogan dans CEPA : “Tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux sociaux et il ne devrait y avoir aucun contrôle de la part d'un gouvernement”. “Son attitude quasi anarchique semble faire écho à l'idéologie du premier mouvement des hackers des années 1980, mais ce n'est pas une stratégie viable aujourd'hui, alors que les gouvernements du monde entier sont à l'offensive contre l'approche libertaire du web”, notent les deux journalistes russes en exil, pour qui “personne – à part peut-être les géants de la technologie eux-mêmes – ne peut vraiment contester qu’à l’évidence des réseaux sociaux non régulés peuvent causer beaucoup de dégâts. Le temps des réseaux sociaux non modérés est révolu depuis longtemps.”
“La coercition par l’Etat est-elle le seul moyen de faire respecter les règles ?”, interrogent Soldatov et Borogan, qui fournissent un début de réponse : “Les réseaux sociaux sont un élément essentiel de notre tissu social ; notre société, par l'intermédiaire d'ONGs, de parlements et d'auditions parlementaires, est parfaitement capable de créer des mécanismes de contrôle qui n'incluent pas l'arrestation des PDG pour manque de modération”.
Pour ma part, je continue à utiliser Twitter, comme je continue de l'appeler, car j'y trouve encore des informations utiles et fiables, partagées par des personnes qui ont à cœur le partage et l'échange, bien que noyées sous un déluge de publicités, d'infox et d'imprécations. Mais je comprends tout à fait ceux qui l'ont quitté en claquant la porte.
En partenariat avec Display Europe, cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent cependant que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie. Ni l'Union européenne ni l'autorité subventionnaire ne peuvent en être tenues pour responsables.

Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !