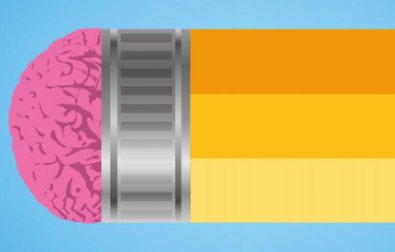Comme dans la plupart des autres pays au passé socialiste, l’évolution de l’économie bulgare est caractérisée depuis 1989 par une importante désindustrialisation et l’affirmation du secteur des services, qui emploie aujourd’hui plus de la moitié des salariés du pays, 57,66 % en 2022.
Ce secteur est animé par diverses activités liées au tourisme et aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Si le départ des touristes russes alimente des inquiétudes légitimes pour les resorts de la mer Noire, les TIC ont clairement le vent en poupe, notamment à Sofia, la capitale bulgare, ou même le maire Vassil Terziev (Nous continuons le changement - Bulgarie démocratique, centre droit) est issu du monde de la tech.
Elu en novembre 2023 au sein d’une coalition pro-européenne et anti-corruption, Terziev est le fondateur de Telerik, une entreprise qui fournit des outils de développement pour des applications de bureau, web et mobiles. En 2014, elle a été revendue pour une somme record de 262,5 millions de dollars à Progress Software Corporation, un éditeur américain de logiciels coté au NASDAQ.
Avant d’entrer en campagne (il a démissionné depuis), Terziev se consacrait encore au conseil et à l’investissement dans les start-ups bulgares, par l’intermédiaire du fonds d’investissement Eleven Ventures et de l’organisation Bulgaria Innovation Hub, basée à San Francisco, ainsi qu’à la formation via la Telerik Academy Foundation.
Le secteur des TIC bénéficie d’une image positive, alimentée par les success story de certains fondateurs, dont les parcours semblent aux antipodes des atavismes de l’Homo Sovieticus bulgare : “Docile, sans imagination, incapable de prendre des initiatives ou de communiquer avec les clients”, selon l’anthropologue Tsvetelina Hristova.
Le contraste entre la modernité supposée d’activités en grande partie dématérialisées, et la lourdeur de l’administration publique est également exacerbée. Plusieurs plans de numérisation et de modernisation de l’administration ont d’ailleurs été entrepris depuis 2015. En une dizaine d’années, Sofia est ainsi devenue une ville de contrastes, où des teslas rutilantes défilent dans des quartiers résidentiels où les habitants se chauffent encore au petit bois.
Certaines start-ups ont déjà une renommée internationale, ou du moins continentale, à commencer par Payhawk, la première “licorne” (start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars, non filiale d’un grand groupe et non cotée en bourse) de Bulgarie. Le pays s’est surtout taillé une réputation dans la deeptech (nouvelles technologies innovantes), la fintech (nouvelles technologies du secteur financier) et l’intelligence artificielle. Avec ses 40 000 mètres carrés sur les abords du mont Vitosha, le Sofia Tech Park est la première et la plus grande surface des Balkans consacrée uniquement à cette économie. Elle profite d’un large investissement issu de fonds privés et de l’Etat bulgare, qui y voit l’opportunité de créer plus de 15 000 emplois directs.
Mais derrière le storytelling de la “Silicon Valley of Southeastern Europe” – comme le Département du Commerce des Etats-Unis désigne la Bulgarie – se cache une réalité bien plus complexe, car le secteur est composé d’un grand nombre d’entreprises étrangères qui pratiquent l’externalisation : 802 au total en 2023, selon l’association corporatiste AIBEST. Ces compagnies sous-traitent tout type d’activités : production, administratif, marketing, service juridique, assistance et support clientèle.
Les plus représentatifs du secteur se nomment Hewlett-Packard, Akkodis, ou Atos. Parmi celles qui sont spécialisées dans le support clientèle, Telus, Concentrix, Alorica ou Sutherland se sont taillés la part du lion. Vous tomberez peut-être sur un call-center bulgare si vous contactez les services clients de Deutsche Telecom, Spotify, Hilton, North Face, Nike, Paramount +, Microsoft, Google, ou une des nombreuses mutuelles de santé françaises qui ont délocalisé leurs services dans ce petit pays des Balkans.
En tout, plus de 104 690 employés travailleraient à temps plein dans la sous-traitance en Bulgarie. C’est en tout cas le chiffre avancé par AIBEST dans un rapport datant de 2023. Une bonne partie travaille à répondre aux mails, aux appels et aux discussions avec des consommateurs ou des professionnels, ainsi qu’à la modération de contenus sur les réseaux sociaux. Si l’on ne prend en compte que les call-centers téléphoniques, le chiffre serait de 11 831 personnes, selon l’Institut national de statistiques.
En tant que pays périphérique de l’Europe, la Bulgarie n’est d’ailleurs pas une exception. Le Portugal, l’Irlande, l’Estonie ou Chypre sont également devenus des destinations de choix pour les externalisations et les services clientèles.
En Bulgarie, la croissance de ce secteur n’a jamais été démentie depuis les années 2010. Le pays reste le plus pauvre de l’UE : le salaire minimum y est de seulement 460 euros bruts, ce qui en fait la main-d'œuvre la moins chère d’Europe. Un chiffre à mettre en perspective avec le salaire moyen, qui est d’environ 1000 euros dans le pays et de 1400 euros dans la capitale.
Ces entreprises profitent également du faible taux d’imposition (10 %) et de la qualité des formations en langues, renforcée par le séjour de nombreux Bulgares à l’étranger lors de leurs études ou lors d’un déménagement en dehors du pays. Enfin, la brutalité de la transition économique des années 90 a suffisamment marqué les mentalités pour que les employés de ces grands groupes internationaux se contentent de peu.
Le pays reste le plus pauvre de l’UE : le salaire minimum y est de seulement 460 euros bruts, ce qui en fait la main-d’œuvre la moins chère d’Europe
Les organisations patronales ont également largement investi les universités afin de créer des formations dédiées, créant des ponts naturels entre les jeunes diplômés et le service à la clientèle. Selon Tsvetelina Hristova, elles estiment même “que les enfants devraient apprendre les techniques de communication dès leur plus jeune âge, [pour] être de bons travailleurs de service.”
Un accord entre l’Université bulgare de Veliko Tarnovo et l’entreprise belge Euroccor va même plus loin, en installant un call-center directement dans l’enceinte de l’établissement. Les employés sont ensuite directement recrutés au sein du département de langues étrangères.
Travailleurs bulgares dévalorisés et européens paupérisés
Selon les travaux des anthropologues Tsvetelina Hristova et Christina Korkontzelou, la main d’œuvre de ces entreprises serait composée de quatre publics assez différents, mais difficilement quantifiables : des jeunes Bulgares sortis de l’université, des travailleurs en reconversion professionnelle, des émigrés revenus au pays, et des étrangers.
La première catégorie est captée pendant les études ou à la sortie de l’université. Qualifiée et facile à façonner, cette main d'œuvre est particulièrement appréciée. La deuxième est le produit de la faillite du secteur public bulgare, miné par les privatisations et la corruption endémique. Il s’agit de personnes formées à d’autres métiers, comme des professeurs de langues, mais dont les salaires sont tellement bas qu’ils sont obligés de travailler ailleurs (en 2022, le salaire d’un professeur débutant était de 723 euros brut).
Les émigrés revenus au pays sont une catégorie non négligeable, ceux-ci représentant une main d’œuvre qualifiée tant par les diplômes que par l’expérience. C’est la raison pour laquelle des entreprises comme Telus n’hésitent pas à monter des campagnes publicitaires destinées à ce public. Les candidats au retour peuvent ainsi toucher jusqu’à 5000 levas (2500 euros) de primes. Depuis la crise du Covid-19 et l’accélération du travail à distance, un certain nombre de Bulgares peuvent même s’offrir le luxe de travailler directement depuis leur village d’origine.
Les étrangers travaillant dans ce secteur peuvent se diviser en deux groupes, également difficilement quantifiables.
Le premier, qui rassemble la population la plus visible dans les grandes villes bulgares, est constitué de jeunes Européens non qualifiés issus des classes populaires, provenant la plupart du temps de régions périphériques et paupérisées. En Bulgarie, ils intègrent artificiellement une “élite nomade et expatriée” en gagnant un peu de pouvoir d’achat, comme le souligne Tsvetelina Hristova. Ils sont recrutés directement dans leur pays d’origine, via les plateformes habituelles de recherche d’emploi, y compris celle de France Travail. Certains enchaînent ce genre de postes dans plusieurs pays européens.
En Bulgarie, des agences de recrutement sont entièrement mobilisées à cette activité, profitant des primes versées par les grandes entreprises du secteur. Ces primes peuvent également être versées aux employés qui coopteraient des amis. Elles vont de quelques centaines d’euros à près de 1000 euros, c’est-à-dire l’équivalent d’un ou plusieurs salaires mensuels.
Le deuxième groupe concerne les personnes originaires de l’extérieur de l’Europe, notamment du Maghreb ou du Moyen-Orient, qui mettent à profit leurs compétences en français, en anglais et en arabe. Ces emplois sont souvent un tremplin vers d’autres activités, plus en phase avec leurs qualifications et leur projet de vie, mais aussi vers des pays plus riches de la zone euro. En 2023, environ 23 000 ressortissants de pays hors UE ont obtenu des permis de travail en Bulgarie, tous secteurs et origines confondus. C’est donc une population encore très limitée en nombre.
Des conditions différenciées selon les origines
Les conditions de travail dans ces entreprises sont marquées par une dépersonnalisation et un micro-management attentif au moindre détail, notamment à l’organisation du temps de travail. Les pauses sont minutées et les employés n’ont que très peu la main sur leur emploi du temps, qui change chaque semaine ou chaque mois. Les postes les plus convoités sont logiquement ceux qui n’imposent pas d’horaires nocturnes ou de travail le week-end, et dont les horaires sont fixes pendant la semaine. La plupart des entreprises ne permettent pas de prendre librement des congés, notamment en été, car une baisse d’activité nuirait à leur compétitivité.
Les rémunérations, qui oscillent généralement entre 800 et 1200 euros (salaire net, sur la base d’un contrat 40 heures par semaine), sont composées de salaires et de multiples avantages que ces entreprises font miroiter à leurs employés comme des ”bonus” : primes à la performance ou à la ponctualité et réductions dans des centres commerciaux – où s’installent nombre de ces entreprises – ou dans des clubs de sport.
L’écart des salaires représente une des sujets de désaccord entre les employés bulgares et européens. Les locuteurs natifs sont payés plus que les Bulgares, et ce quelle que soit leur expérience. Les langues n’ont pas non plus la même valeur, ce qui n’est pas de nature à créer une solidarité entre les employés. En bas de l’échelle se retrouvent le bulgare et l’anglais ; les langues scandinaves, quant à elles, assurent généralement à leurs locuteurs le meilleur salaire.
L’absence criante des syndicats
Les grandes confédérations syndicales sont absentes de ces entreprises, et ne possèdent aucune donnée, tant sur le nombre des employés que sur les conditions de travail. “Nous n’avons pas de syndiqués dans ces entreprises, ces employés ne nous contactent pas, donc nous n’avons pas de raison d’avoir des données” confesse une des responsables de l'Isturet, l’Institut de recherche de la principale confédération syndicale du pays, la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CSIB). Héritière directe du Conseil central des syndicats (CCS) de l’époque socialiste, elle est toujours hébergée dans ses anciens locaux, une tour à l’architecture brutaliste du centre de Sofia.
En réalité, le poids des syndicats est très faible dans le secteur privé bulgare, avec un nombre d’accords collectifs très limités, comme le relève la directrice de l’Observatoire social européen Slavina Spasova, dans Trade unions in the European Union (2023, Institut syndical européen). Les coordinateurs de l’ouvrage, les chercheurs Torsten Müller et Kurt Vandaele, expliquent également “qu’il est notoirement difficile de s'organiser dans ces entreprises, et pas seulement en Bulgarie. De nombreuses multinationales poursuivent des stratégies antisyndicales en essayant de maintenir les syndicats en dehors de leurs lieux de travail”. Pour eux, les centres d’appel constituent “un excellent exemple de stratégies d'évitement et de démantèlement des syndicats, la technologie de surveillance étant très utile dans ce contexte.”
L'anthropologue Christina Koroukolou avance aussi une autre hypothèse, selon laquelle “les syndicats bulgares ont peut-être peur de provoquer le départ de ces entreprises du pays et que les employés perdent leurs emplois.”
Pourtant, Slavina Spasova met en avant un impact réel des syndicats sur la société bulgare – même si le dialogue social y est essentiellement bipartite, c’est-à-dire entre les confédérations syndicales et l’Etat. La chercheuse souligne une prise en compte des réalités sociales actuelles, avec un rôle important joué par l’Isturet, qu’elle présente comme “un des instituts syndicaux de recherche les plus actifs de l’UE”. Selon elle, l’organisation aurait même ”joué un rôle crucial en fournissant une expertise sur les politiques industrielles et sociales.”
Si Torsten Müller et Kurt Vandaele défendent que “les syndicats bulgares ont récemment réussi à organiser des secteurs autrefois non syndiqués, tels que dans l'industrie des TIC, qui compte une forte proportion de jeunes employés”, force est de constater que ce n’est pas le cas dans les entreprises qui sous-traitent l’assistance et le support clientèle – le syndicat créé par la CSIB pour les employés des TIC n’existe d’ailleurs plus. Seul subsiste celui de l’autre confédération syndicale du pays, CL Podkrepa, qui s’adresse plutôt aux employés de la tech (programmeurs, analystes, développeurs, etc.).
Les employés bulgares de ces entreprises évoquent quant à eux leur défiance envers des syndicats qui sont encore trop marqués par leur affiliation au régime et au Parti socialiste bulgare, héritier à son tour de l’ancien Parti communiste. Plus que leur couleur politique, c’est leur possible instrumentalisation qui semble marquer le manque de confiance du service à la clientèle. Pourtant, le manque d’une organisation qui pourrait prendre la défense des travailleurs, individuellement ou collectivement, se fait cruellement ressentir.
Des résistances solitaires et des licenciements en ligne
Les formes de résistance au sein de ces entreprises prennent souvent des tours individuels qui pourraient sembler presque anecdotiques. Les employés étrangers pratiquent régulièrement l’absentéisme (congés maladie ou abandon de poste), une des hantises des managers intermédiaires, qui doivent à tout prix justifier à leur hiérarchie la rentabilité de la main-d'œuvre.
Ils peuvent également choisir de quitter leur poste pour une autre entreprise, car les recrutements à Sofia, Varna et Plovdiv vont bon train : il est courant pour des locuteurs natifs de trouver un nouvel emploi en quelques jours.
Les employés ont l’habitude d’échanger entre collègues des solutions techniques aux velléités de contrôle du micro-management : “mouse jiggler” (application permettant de simuler une activité de la souris), manipulation des données ou des horaires de présence, raccourcis et techniques pour finir les tâches plus rapidement, etc. Une autre combine récurrente, plus spécifique à la Bulgarie, est de prétexter une panne d’électricité, un phénomène encore habituel en dehors des grandes villes. Mais d’une manière générale, il semble très difficile pour les employés bulgares de pouvoir s’imposer collectivement pour une amélioration de leurs conditions de travail ou de leur rémunération.
D’abord, parce qu’ils sont tétanisés par la peur de perdre leur emploi, ou d’être mal vus dans un univers qu’ils considèrent comme une porte de sortie crédible aux salaires de misère que proposent d’autres secteurs. Les conditions d’accès aux allocations chômage sont contraignantes et les niveaux de rémunération très faibles (60 % du salaire au maximum, après 12 mois sous contrat au minimum).
La généralisation du travail à distance, plébiscité par les plus jeunes, rend presque impossible les discussions entre collègues. Les managers distribuent la parole lors de réunions dématérialisées, cadrent et espionnent les discussions sur Slack, installent des mouchards pour mesurer les déplacements de la souris. Les licenciements se font généralement en ligne, micro fermé pour les employés.
Le départ de ces entreprises semble pourtant inéluctable, à mesure que les salaires du pays se rapprochent des standards européens et que l’IA apparaît comme un concurrent crédible pour remplacer les travailleurs de ces “bullshits jobs”, selon la terminologie popularisée par l’anthropologue David Graeber dans son ouvrage éponyme.
Avec l’inflation, la qualité des salaires de ce secteur n’est plus aussi évidente. En mars 2024, des grèves ont eu lieu dans de nombreux call-centers de Grèce, à Athènes, Thessalonique, La Canée et dans la région de l’Attique. Elles avaient pour objectif l’augmentation des salaires, en lien avec l’inflation galopante dans ce pays voisin de la Bulgarie.
Dans un futur proche, la difficulté pour la société bulgare sera probablement de trouver la capacité de rebondir, une fois usée une partie de sa main d’œuvre dans des postes non-qualifiants et sans aucune utilité pour la vie locale. Depuis les années 90, plus d’un million et demi de Bulgares ont quitté le pays, qui manque terriblement de professeurs, d’infirmières ou d’employés du bâtiment.
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !