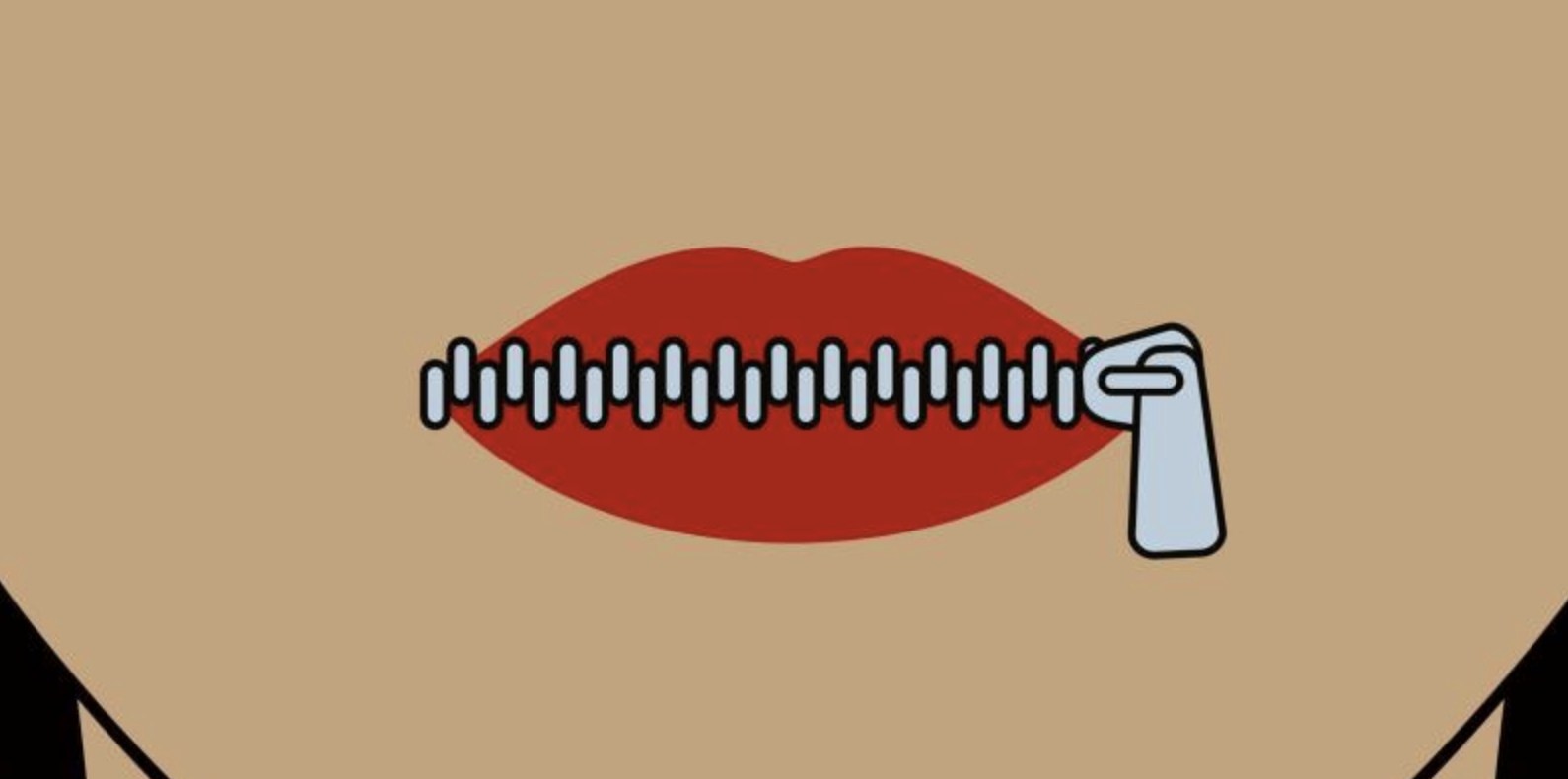Le 6 février 2024, le Parlement européen et le Conseil européen sont parvenus à un accord concernant la Directive européenne sur les violences faites aux femmes proposée en mars 2022. Ce texte doit permettre une harmonisation de la législation des Etats membres en matière de harcèlement sexuel, de mutilation génitale féminine, de stérilisation, de mariage forcé et de “revenge porn” (“vengeance pornographique”, la divulgation d’images à caractère sexuel dans le but de nuire à une personne).
L’article 5, portant sur une définition européenne du viol basée sur l’absence de consentement a été écarté de la version finale, faute d’accord trouvé. Mais il est malgré tout parvenu à ouvrir et élargir un débat sur la législation sur le viol et la notion de consentement sexuel à travers toute l’Europe.
Depuis le lancement en 2018 du mouvement #MeToo, qui a vu déferler une vague de dénonciation d’agresseurs via les réseaux sociaux, le terme “consentement” est sur toutes les lèvres. Issu du domaine juridique, il fait l’objet de nombreux débats quant à son implication précise dans un contexte sexuel et sentimental.
Le débat sur l’article 5
Le vote de l’article 5 aurait impliqué un changement des textes de loi dans tous les Etats membres ne disposant pas d’une définition légale du viol basée sur le consentement, tels que la France, le Portugal, l’Italie ou encore la Pologne. L’Espagne, la Suède, la Finlande, la Slovénie, le Danemark et les Pays-Bas ont pourtant déjà franchi le pas vers une législation dite du “seul oui veut dire oui”.
La décision de ne pas inclure cet article s’est jouée à très peu : un changement de position de la France ou de l’Allemagne aurait suffit à le faire adopter. La cause officielle invoquée ? Le viol ne fait pas partie des “eurocrimes” tels que definis par l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE).

L’Union européenne a ratifié la Convention d’Istanbul qui établit bien une définition du viol basée sur le consentement s’aparentant au fameux article 5. Si la France et l’Allemagne en sont toutes deux également signataires, la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie manquent encore à l’appel.
Selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), 55%, soit plus de la moitié des femmes de l’Union Européenne, ont été harcelées sexuellement depuis leur 15 ans, et une sur trois, soit 33%, ont enduré des violences physiques et/ou sexuelles.
Entre 2021 et 2023, plus de 68 000 plaintes pour viol furent enregistrées en Europe, d’après les données récoltées par le Mediterranean Institute for Investigative Reporting (MIIR), dans le cadre d’une enquête de l’European Data Journalism Network (EDJNet) à laquelle Voxeurop a participé. Or, le viol et les aggressions sexuelles restent les infraction les moins rapportées aux autorités. En Irlande notamment, seuls 5% des agressions sexuelles font l’objet d’un dépôt de plainte, selon le Bureau central des statistiques.
Si la parole se libère, nombreuses et nombreux sont ceux qui voient à présent la défaillance de nos systèmes de soutien et de suivi des victimes, notamment au niveau judiciaire.
Pourquoi insérer la notion de “consentement” dans la loi ?
La notion de “consentement” dans la loi
Une définition du viol basée sur l’absence de consentement de la victime impliquerait que seul le comportement de cette dernière pourrait faire la différence entre viol et rapport sexuel consenti. Cette symbolique culpabilisante est également perçue comme une menace car elle pourrait entraîner une examination minutieuse et malvenue du comportement des victimes.
Cependant, c’est précisément ce qui se passe à l’heure actuelle dans la plupart des systèmes juridiques, dont le modèle français : pour prouver qu’il y a eu usage de la force ou contrainte, les victimes voient déjà leur comportement passé au peigne fin.
Un changement de la loi devrait permettre la prise en charge par la justice de viols qui, aujourd’hui, ne le sont pas. Autre objectif : rendre plus difficile aux violeurs avérés de passer entre les mailles du filet.
Frédérique Pollet-Rouyer, avocate spécialisée dans la défense des victimes de violences sexistes et sexuelles, et corédactrice d'une tribune publiée dans Le Monde en décembre 2023, signée par un collectif d’avocates, d’autrices et de magistrates au titre très explicite : “Violences sexuelles : « Il est urgent de redéfinir pénalement le viol, dont la définition, en France, présuppose un consentement implicite »”. Elle explique : “Dans le droit actuel, un acte sexuel dont il est établi pourtant qu'il n'est pas consenti n'est pas considéré comme un viol dès lors qu'il n'est pas démontré que le mis en cause a exercé une violence physique sur la victime, ou bien l'a surprise, menacée ou contrainte.”
Elle poursuit : “L’idée qui imprègne le droit aujourd’hui [en France], c’est qu’il faut avoir résisté et que le viol est le fruit d’une reddition […]. Or dans bon nombre de cas, la victime n'aura pas été à même d'opposer une résistance verbale ou physique à son agresseur, en raison de son état de sidération au moment des faits, ou bien du fait qu'elle n'a pas été en mesure de réagir en raison de son état de vulnérabilité, de sa précarité, de l'autorité morale que son agresseur, qu'elle connait le plus souvent parce que c'est un père, un mari, un supérieur hiérarchique, exerce sur elle. À défaut de pouvoir démontrer qu'il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise, le défaut de consentement, quoi qu'établi, ne permettra pas de caractériser pénalement le viol, l'agresseur pouvant se targuer du fait qu'en l'absence de résistance, parce qu'elle n'a pas bougé et n'a pas dit non, il a pu légitimement penser que sa victime était consentante. Autrement dit, le droit pénal actuel repose sur une présomption de consentement de la victime et des stéréotypes bien ancrés sur ce qu'est une relation sexuelle entre un homme et une femme, qui fait échapper l'essentiel des viols à la sanction pénale.”
S’éloigner de ce statu quo, tel est l’objectif des partisans et des partisanes de l’inscription du non-consentement dans la législation.
La notion de consentement reste donc au cœur des débats, même dans les tribunaux de systèmes judiciaires à la législation basée sur la contrainte et la force. Tout l'enjeu réside dans l’interprétation du terme, ou comment le façonner de manière à ce qu’il ne desserve pas les victimes. C’est bien là que réside un terrain d’entente.
Un débat aussi dans le milieu féministe
Le 29 janvier 2024 en Allemagne, une lettre ouverte signée par plus de 100 femmes issues des secteurs de la culture, de l’économie ou de la politique, a été envoyée au ministre fédéral allemand de la Justice Marco Buschmann. Les signataires y ont plaidé l’adoption de la directive dans sa forme originale.
Dans une tribune au Monde datant de décembre 2023, la philosophe et essayiste féministe Manon Garcia met au contraire en garde contre un basculement de la loi française sur le viol vers une version basée sur le non-consentement : “C’est une erreur – et une erreur sexiste ! – que de définir le viol par le non-consentement”, écrit-elle.
En Espagne, pays ayant franchi le pas d’une loi dite “seul oui veut dire oui”, c’est la penseuse féministe Clara Serra qui, dans les pages de El Diario, questionne le bien-fondé d’une telle définition légale du viol. Selon elle, si on considère qu'une femme ne peut pas exprimer son désaccord à cause de dynamiques de domination, on devrait appliquer le même raisonnement à une femme qui dit "oui" explicitement. Ce consentement pourrait tout aussi bien être le pur produit de ces mêmes dynamiques de pouvoir.
D’après Frédérique Pollet-Rouyer, “Dans une société patriarcale, c'est à dire inégalitaire entre hommes et femmes, quand on parle de consentement, il ne peut s'agir d'une conception libérale de ce dernier, sauf à admettre qu'une femme qui n'a pas d'autre choix que de céder et de subir un viol, en raison de la situation de contrainte dans laquelle elle se trouve, est consentante. Ce n'est pas ce consentement là que l'on défend évidemment mais un consentement situé au regard des circonstances qui entourent le viol et qui implique nécessairement de questionner le rapport de pouvoir existant entre la femme qui se plaint et l’homme qu’elle désigne. Parce que si on n’interroge pas les rapports de pouvoir, on ne comprend pas la majorité des situations de viol.”
Jana Kujundžić, chercheuse spécialisée dans les violences sexistes, résume : “Je pense qu'un changement positif dans la loi sur le viol doit mettre en évidence une compréhension contemporaine et fondée sur des preuves du viol et de la violence sexuelle en tant que problème social.”
Un changement des textes agirait comme catalyseur d’un débat à grande échelle sur les questions de consentement. Si chaque citoyen et citoyenne européenne avait ne serait-ce qu’à se confronter à la question du consentement sous l’angle des rapports de force et du contexte, l’apport pédagogique serait de taille. L’article 36 de la directive contraint d’ailleurs les Etats membres à mettre en place des actions de sensibilisation sur le consentement.
L’eurodéputée et rapporteuse du texte Ervin Incir (Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, S&D) estime même que la directive “pourrait générer la pression nécessaire pour que les gouvernements nationaux mettent à jour leurs définitions juridiques afin de s'aligner sur les normes internationales en matière de droits humains, telles que celles énoncées dans la Convention d'Istanbul. À l'avenir, nous prévoyons que la Commission européenne proposera une nouvelle législation portant spécifiquement sur le viol, en s'appuyant sur ces progrès.”
Une petite lueur d’espoir que souligne également la deuxième rapporteuse Frances Fitzgerald (Parti populaire européen, centre droit), eurodéputée irlandaise : “Lorsqu'il s'agit de relations sexuelles, le consentement doit être au cœur de la conversation. […] Je pense que cette directive peut apporter un changement fondamental à notre façon de penser la société– en créant un impact au-delà du seul droit pénal".
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !