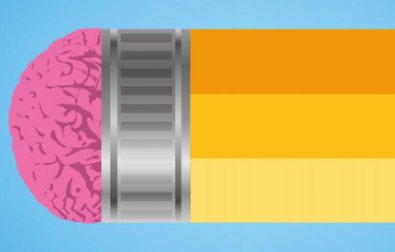Pour l'auteur d'Aux frontières de l'Europe (éd. Hoebeke, 2011), il n'y a guère plus que dans certains ex pays communistes et le long de la frontière extérieure de l'UE que l'on peut encore rencontrer l'âme du Vieux continent.
Comment vous est venue l'idée de parcourir en long et en large la frontière orientale de l'Union européenne ?
Je cherchais une frontière qui fut encore telle. Je viens de Trieste, je suis un fils de la frontière. Je suis né le jour même où la frontière a été établie autour de Trieste, le 20 décembre 1947. Cette frontière a été abattue le jour de son soixantième anniversaire [lors de l'entrée dans l'espace Schengen de plusieurs pays d'Europe orientale], qui coïncide avec mon soixantième anniversaire. Ce soir-là, nous nous sommes regardés, ma compagne polonaise [la photographe Monika Bulaj] et moi, et nous nous sommes dits : "Après avoir passé soixante ans à vouloir abattre les frontières, comment allons-nous faire, maintenant que la frontière n'existe plus ?" C'était là une formidable invitation au voyage : où est passé à présent le sens du mystère qu'avait la frontière ? Ce jour-là, un peu éméchés, un peu euphoriques, alors que nous sciions la vieille barrière de la frontière yougoslave, au milieu d'un bois de la vallée de Rosandra où se trouvait la dernière auberge italienne avant la Yougoslavie, j'ai décidé que je partirais à la recherche de cette véritable frontière : un endroit où je trouverais encore de véritables gardes-frontières.
Les avez-vous trouvés ?
Et comment ! Vous vous rendez compte ? Si j'avais fait ce voyage il y a vingt-cinq ans, [une fois rentré en Slovénie], je n'aurais jamais dû montrer mon passeport, car je serais resté dans l'espace du pacte de Varsovie et de l'ancienne URSS. Cette fois-ci, au contraire, les entrées et sorties continuelles de l'espace Schengen et de l'Union européenne (UE) ont fait que je me suis retrouvé —spécialement entre la Norvège et la Russie et entre la Lettonie et la Russie — face à des frontières d'une rigidité incroyable, bien plus qu'avant la chute du Mur. Je voulais voir ce qu'il y avait derrière cette barrière, cette limite. On se rend vite compte qu'il n'y a aucune différence entre un côté et l'autre de la frontière, malgré ces barrières absurdes, et qu'en réalité la ligne de frontière de l'UE court le long d'une série de régions transfrontalières aux noms magnifiques, comme Courlande [Lituanie] ou Botnie [Scandinavie] ou encore Dobroudja [Roumanie/Bulgarie], qui existaient avant la grande fièvre nationaliste du XIXe siècle et qui constituent le véritable cœur du continent.
On dit que le centre géographique de l'Europe est quelque part à l'ouest de l'Ukraine…
L'Europe a plusieurs centres : un en Lituanie, un dans les Carpates, un en Pologne… Cela dépend de comment on mesure l'Europe. Ce qui est certain, c'est qu'elle est plus haute que large. Le centre de l'Europe n'est pour le moment qu'une pâle imitation de l'Occident, même si l'on retrouve de fortes traces de l'Orient. Ce mélange de slavitude et de judaïsme, qui est l'âme profonde de l'Europe, je ne l'ai trouvé que dans ces régions frontalières. C'est là que bat pour moi le cœur de l'Europe tel que je l'entendais et je le recherchais : une certaine féminité maternelle, de grands fleuves, c'est en Russie, en Ukraine, en Pologne que je les ai trouvés.
De votre récit émane un amour quasi immodéré pour l'esprit slave et le style de vie des personnes que vous avez rencontrées. Et une forme de dégoût vis-à-vis de certains aspects de l'Europe occidentale. Quel est son problème ?
C'est un monde plus homogène, plus faux, en celluloïd, où le temps court chaque jour plus vite et se consume dans une corrida d'e-mails et de textos, où l'on a perdu le contact avec la terre – "zemljia", en russe ; un nom qui, avec "voda", l'eau, m'a suivi tout au long de mon parcours.
Dans votre livre, vous faites l'éloge de l'authenticité des habitants de ces régions de frontière. Pourtant, nombre d'entre eux n'ont qu'un souhait, c'est de vivre en Europe occidentale ou, en tout cas, d'en adopter le style de vie.
Il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Sans vouloir leur dire qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, on peut toutefois leur rappeler que tout n'est pas rose de ce côté-ci de la frontière. Les personnes âgées en sont conscientes : elles se rendent compte que la solidarité qui marquait les relations entre les personnes n'existe plus parmi les jeunes occidentalisés.
Vous évoquez souvent l'"âme slave" dans votre livre. Comment la définiriez-vous ?
Les Slaves sont conscients de ne pas constituer le cerveau du continent, mais d'en être en quelque sorte les tripes. Ils laissent se manifester leurs instincts et cela peut déboucher sur une agressivité incroyable, mais aussi en une tendresse inoubliable dans d'autres situations. Dans mon livre, je raconte une scène à Minsk, où un accordéoniste est approché par un groupe de jeunes femmes qui lui disent : "Allez, Igor, fais-nous pleurer !" Un Occidental ne l'aurait jamais fait. Il aurait demandé une chansonnette pour anesthésier sa vie trop rapide, trop privée de sens. Ce que j'aime chez les Slaves, c'est ce partage de la partie ténébreuse de leur vie, de la mélancolie.
L'adhésion d'une dizaine de pays ex-communistes à l'UE a-t-elle changé l'Europe ?
Oui, parce qu'ils ont apporté une injection de nationalisme remarquable : de ce point de vue, les Polonais sont un désastre. Cette sensation qu'ils sont un peuple martyr, qui a résisté au moloch communiste. Ils ont redécouvert le nationalisme après la fin du nationalisme. En Pologne, c'est pathologique. C'est un monde autocentré. Ce qui s'est produit avec l'avion du président Lech Kaczynski [qui s'est écrasé à Smolensk en avril 2010] est exemplaire : pas question de passer pour des imbéciles face aux Russes !
Dans votre livre, vous semblez faites des reproches à l'Europe et à ses institutions…
Je reproche à l'Europe et à l'Italie de dormir et de ne pas se rendre compte des forces nationalistes et centrifuges qui la tiraillent. Nous n'avons pas retenu la leçon des Balkans : il suffit que l'on indique un ennemi à une population en manque de repères pour que celle-ci l'adopte comme tel. Aujourd'hui, une classe dirigeante en échec qui voudrait transformer un bras de fer politique en bras de fer ethnique n'aurait aucun mal à le faire. Nous n'avons plus les anticorps antifascistes, mais nous n'avons plus non plus les anticorps de la critique. De ce point de vue, l'Italie – mais aussi la Belgique – est une zone à risque. On y trouve une victimisation régionaliste exaspérée. Une forme de rancoeur de la périphérie vis-à-vis du centre.
Propos recueillis par Gian Paolo Accardo
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !