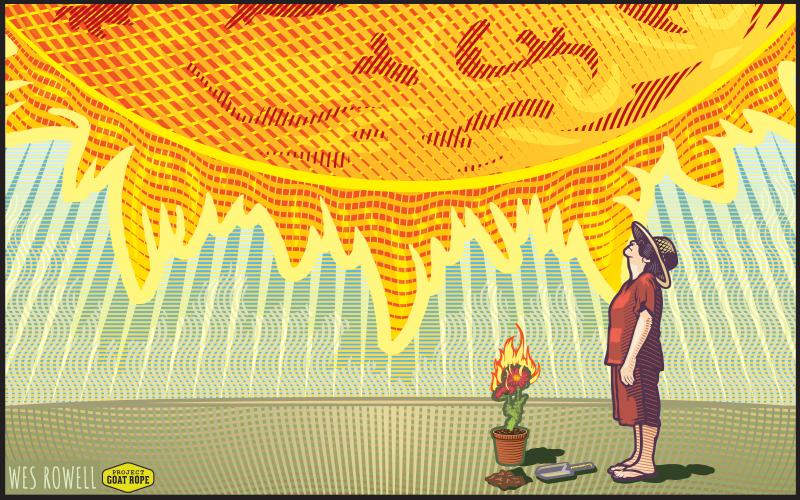Affirmation à vérifier : Lors des discussions sur le règlement de l'UE relatif à la restauration de la nature, début 2024, le parlementaire européen néerlandais des Conservateurs et réformistes européens (ECR, extrême droite) Bert-Jan Ruissen a affirmé que “trop de terres étaient réservées à la restauration de la nature”. Comme plusieurs autres responsables de droite et d'extrême droite, il a repris l'argument selon lequel les politiques de conservation nuisent à la stabilité économique.
Contexte : La loi européenne sur la restauration de la nature est un élément clé du Pacte vert pour l’Europe – "EU Green Deal" en anglais –, et entend inverser la perte de biodiversité et atténuer le changement climatique.
Présenté par la Commission en 2022, le texte ambitionne, entre autres, de restaurer au moins 20 % des zones terrestres et maritimes de l’UE et 30 % de tous les habitats terrestres, côtiers et d'eau douce considérés comme “en mauvais état” d’ici à 2030, puis d'assurer la restauration de tous les écosystèmes dégradés d’ici 2050.
L’extrême droite européenne n’a pas été la seule à se dresser contre la loi ; anticipant un changement, le Parti populaire européen (PPE, droite) a nourri les inquiétudes concernant les mesures environnementales proposées, qui pourraient selon lui menacer les agriculteurs, l'approvisionnement en nourriture et la stabilité économique. À l’approche des élections européennes de 2024, le débat politique sur la question a commencé à s’échauffer. Les partis de droite ont repris certaines déclarations, comme celle de Ruissen, pour attaquer le Pacte vert et gagner des voix.
À l'approche des élections européennes de 2014, les candidats de droite espéraient une chose : éloigner la composition de la nouvelle majorité de celle – plutôt progressiste – de 2019. Au sein de cette dernière, les Verts avaient pu jouer un rôle décisif pour la première fois, dans le sillage de mouvements populaires tels que Fridays for Future.
L'eurodéputé néerlandais d'extrême droite Bert-Jan Ruissen et ses pairs ont entamé une série d'actions visant, sinon à démanteler le “Green Deal” européen, au moins à en limiter l'application au prétexte que ses propositions menaceraient la justice sociale et la stabilité économique du continent. En février 2024, Ruissen était rapporteur fictif au sein de la commission de l'agriculture pour l'élaboration du règlement sur la restauration de la nature, connu sous le nom de “loi sur la nature” dans le débat public.
Dans ce débat, la droite et l’extrême droite jouent la carte du “réalisme” : c’est parce que la transition verte est coûteuse et risque de laisser de côté les citoyens dont les emplois et la vie entière dépendent encore des modes de production traditionnels qu’elle doit être révisée et rendue plus “pragmatique”.
Pour Marlene Mortler, ancienne députée européenne du PPE, qui a rédigé un rapport sur la sécurité alimentaire, “le Green Deal ne doit pas mettre en péril la sécurité alimentaire”. Pour elle, la restauration de la nature fait courir un potentiel risque, celui de rendre davantage de terres “inutiles” en raison des mesures de protection.
Appelant à un rejet total de la proposition de la Commission, le leader du PPE Manfred Weber avait déclaré en 2023 que “l'objectif de la loi est de restaurer la nature dans son état de 1950”. “Elle met les collectivités locales et régionales au défi de faire l'impossible : revenir sur 70 ans de changements dans la nature en 25 ans environ”, avait-t-il ajouté.
Une série d’événements malheureux
Les opposants à la loi ont affirmé à tort que de vastes pans de terres agricoles seraient réensauvagées.
En réalité, le texte n'exproprie pas les terres agricoles, car il donne la priorité aux écosystèmes dégradés et reconnaît explicitement la nécessité d'équilibrer la conservation et l'activité économique. Il comprend également des mécanismes de flexibilité, garantissant que les efforts de restauration sont compatibles avec la production alimentaire et les moyens de subsistance ruraux.
Bien que les opposants à la loi aient rendu la procédure législative pénible, un accord a pu être trouvé lors d'une bataille de dernière minute. Le texte a finalement été signé en juin 2024, juste avant les élections européennes.
Le texte obligera les Etats membres de l'UE à restaurer au moins 20 % des types d'habitats couverts par le projet de loi d'ici à 2030, en accordant la priorité aux sites protégés dans le cadre du réseau Natura 2000 existant. Les Vingt-Sept ont maintenant jusqu'au 1er septembre 2026 pour soumettre leurs projets de plans de restauration nationaux à la Commission.
Des affirmations comme celle de Ruissen, même si elles ne sont pas étayées par des preuves scientifiques ou des données disponibles en libre accès, sont un moyen idéal de ruiner la réputation du Pacte vert. Même en 2025, les politiques élaborées payent encore le prix de cette rhétorique.
“Au fur et à mesure que les manifestations [contre le pacte vert] s'étendaient, les lobbies agricoles et la droite conservatrice ont commencé à instrumentaliser ces protestations”, explique l’organisation de défense de l’environnement Terra!.
Avec un certain succès : en 2024, plusieurs textes législatifs européens ont été victimes de ces inquiétudes.
La politique agricole commune (PAC) a été modifiée afin de permettre aux agriculteurs de recevoir des subventions européennes même s'ils ne respectent pas les normes en matière d’agriculture et d’environnement de l'Union.
Le Parlement européen a rejeté le texte d'une proposition visant à limiter l'utilisation des pesticides. Le règlement sur les produits issus de la déforestation a été retardé, suite à la pression des partis conservateurs, qui souhaitaient en atténuer les exigences.
Les émissions de l'agriculture intensive n'ont, quant à elles, pas été assimilées aux émissions industrielles dans les objectifs climatiques de l’UE pour 2040. La stratégie “De la ferme à la table”, le volet agroalimentaire du mandat précédent, pourrait également être déclarée cliniquement morte.
Politiques agricoles néolibérales
Les protestations des agriculteurs ont souvent été présentées comme une réaction directe aux politiques de restauration de la nature. Un examen plus approfondi révèle que leurs préoccupations premières sont ailleurs.
Par exemple, l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur pourrait permettre à des produits agricoles moins coûteux en provenance d'Amérique latine d’entrer sur le marché européen, au détriment des producteurs du continent. Une inquiétude soulignée par le mouvement international La Via Campesina, qui rappelait en 2024 que les agriculteurs en avaient assez “de passer leur vie à travailler sans cesse sans jamais obtenir un revenu décent”.
Contrairement aux affirmations selon lesquelles la conservation des terres nuit à la stabilité économique, la recherche montre – s'il en était besoin – que ne pas restaurer les écosystèmes dégradés présente un risque financier bien plus important.
"Nous en sommes arrivés là après des décennies de politiques agricoles néolibérales et d'accords de libre-échange. Les coûts de production n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, tandis que les prix payés aux agriculteurs ont stagné, voire baissé”, précise La Via Campesina. “Depuis les années 1980, les différentes réglementations qui garantissaient des prix équitables aux agriculteurs européens ont été démantelées. L'UE a tout misé sur les accords de libre-échange, qui ont mis en concurrence tous les agriculteurs du monde, les incitant à produire au prix le plus bas possible, au détriment de leurs revenus et de leur endettement. Produire écologiquement a d'énormes avantages pour la santé et la planète, mais cela coûte plus cher aux agriculteurs, et donc pour réaliser la transition agroécologique, il faut protéger les marchés agricoles. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus.”
Ce que disent les données
Contrairement aux affirmations selon lesquelles la conservation des terres nuit à la stabilité économique, la recherche montre – s'il en était besoin – que ne pas restaurer les écosystèmes dégradés présente un risque financier bien plus important.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) souligne que la dégradation des écosystèmes menace directement la productivité agricole et la sécurité alimentaire : “Le changement climatique observé affecte déjà la sécurité alimentaire en raison de l'augmentation des températures, de la modification des régimes de précipitations et de l'augmentation de la fréquence de certains événements extrêmes”. Et d’ajouter que “la sécurité alimentaire sera de plus en plus affectée par les changements climatiques futurs prévus”.
En outre, poursuit le GIEC, “environ 21 à 37 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) sont imputables au système alimentaire”.
On considère souvent le système alimentaire actuel comme acquis. Cependant, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime qu'il faudra produire environ 50 % de nourriture en plus d'ici à 2050 pour alimenter la population mondiale croissante. “Cela entraînerait une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre et des autres conséquences environnementales, notamment la perte de biodiversité”, indique le GIEC.
Avec deux milliards d'habitants supplémentaires sur la planète Terre, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de continuer à vivre comme nous le faisons. Il n’est pas seulement question d’allouer l’espace différemment. Seules des formes d'agriculture nouvelles et durables peuvent répondre aux problèmes que l'agriculture industrielle a créés au cours des dernières décennies.
“La combinaison d'actions au niveau de l'offre, telles qu'une production, un transport et une transformation efficaces, et d'interventions au niveau de la demande, comme la modification des choix alimentaires et la réduction des pertes et des déchets, permet de réduire les émissions de GES et d'améliorer la résilience du système alimentaire”, indique par ailleurs le GIEC.
Pour le GIEC, l'intervention en amont – au niveau de la production, de la transformation ou du transport des denrées – couplée à une adaptation en aval – changer l'alimentation ou réduire la production de déchets – permet de réduire les émissions de GES, et ainsi “d'améliorer la résilience du système alimentaire”.
Le cabinet de conseil PwC estime que plus de 50 % du PIB mondial est menacé par la perte de biodiversité. La protection de la nature est donc un impératif économique, et non un obstacle. Pour le World Resources Institute (WRI), les investissements dans la restauration de la nature ont par ailleurs des retombées économiques substantielles et créent des emplois.
Si une vision en matière de politique environnementale est nécessaire, il est indéniablement difficile de la proposer dans une période marquée par les guerres et la peur. D'autres mesures climatiques se heurtent à une forte résistance, au nom du statu quo. Ce n'est pas un hasard si la rhétorique derrière l’offensive contre la loi sur la restauration de la nature se retrouve dans le recul d'autres politiques énergétiques.
Alors que la directive européenne sur les énergies renouvelables a porté la part de la consommation d'énergie renouvelable de l'UE à 42,5 % d'ici 2030, avec un supplément indicatif de 2,5 % qui permettrait à l'Union d'atteindre 45 %, certains commentateurs se sont inquiétés du fait que la production agricole pourrait être mise en danger : les infrastructures produisant les énergies renouvelables n'avaient-elles pas besoin d'espace, réduisant ainsi d'autant les terres disponibles pour l'agriculture ? Une inquiétude tempérée par une étude du Bureau européen de l'environnement (BEE) et un rapport publié par l'association européenne de l'énergie Eurelectric, qui affirment que la biodiversité et les réseaux électriques peuvent coexister sans compromettre la nature ou la production alimentaire.
Pour les conservateurs, notre planète est trop petite pour accueillir les activités qui la ruinent et celles qui tentent de la sauver. Ils ont en quelque sorte raison. Mais devinez lesquelles devraient être abandonnées, selon eux ?
Face à l’augmentation des risques climatiques, les scientifiques ne considèrent pas la restauration de la nature comme un luxe ; pour eux, c’est une nécessité. La préservation et la réparation des écosystèmes ne constituent pas une menace pour la stabilité économique, mais bien une protection contre un effondrement futur.

Cet article a été rédigé avec le soutien de l’EMIF (European Media and Information Fund). Le contenu soutenu par le Fonds européen pour les médias et l’information relève de la seule responsabilité de son ou ses auteurs et ne reflète pas nécessairement les positions de l’EMIF et des partenaires du Fonds, de la Fondation Calouste-Gulbenkian et de l’Institut universitaire européen.
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !