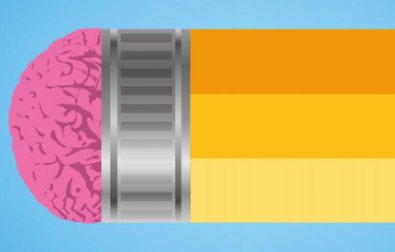Dissidents ou délateurs - leurs noms se trouvent tous sur une même liste. "Cette liste, c’était de la merde. Sous le communisme, je faisais partie du mouvement d’opposition Solidarnosc et, du jour au lendemain, tout le monde a pu penser en Pologne que j’étais un agent de la police secrète", s’énerve encore, quatre ans après, Andrzej Jagodzinski.
La mise en ligne, en 2005, des 160 000 noms de la base de données de la police secrète communiste a provoqué un vent de panique en Pologne. Des millions de personnes se sont connectées sur le site Internet qui l’a publiée. Cette liste des archives, recopiée en cachette, ne fait pas de distinction entre collaborateurs et adversaires du régime. Il y manque même les dates de naissance.
Tout comme l’avaient fait des dizaines de milliers d’autres Polonais, dont les noms figuraient sur la liste, Jagodzinski demanda à l’Institut de la mémoire nationale (IPN), d'où avait été illégalement sorti ce document, de lui expliquer pour quelle raison son nom apparaissait. Neuf mois plus tard, il reçut une lettre officielle de la part de l’IPN, qui lui indiquait qu’il avait été surveillé en raison de son statut d’ "individu hostile".
Il y a en creux, derrière ce jargon bureaucratique de l’IPN, toutes les émotions qui bouleversent la Pologne depuis que la liste a été publiée. On l’appelle "la liste de Wildstein", du nom du journaliste, Bronisław Wildstein, qui l’a diffusée le premier. Wildstein, ancien dissident et émigrant au parcours assez tortueux, est l‘un des plus farouches opposants à cette opinion qui entend "tirer un trait définitif" sur le passé. A travers cette action pirate, il est semble-t-il parvenu à ses fins. Le passé s’échappe des archives polonaises comme des bulles d’air sous pression.
Une chose est sûre : le spectre du régime communiste, qui a tenu des millions de gens sous son joug et les a moralement brisés, est réapparu en Pologne. Personne ne sait aujourd’hui ce que recèlent encore les archives et "qui" pourrait bien en faire usage et "contre qui".
Un processus difficile en Hongrie et en Pologne
Pourquoi les approches du passé en Europe centrale sont-elles si différentes d’un pays à l’autre ? Pourquoi la Hongrie et la Pologne, premiers pays à avoir adopté un régime démocratique, sont-ils parmi les derniers à affronter ce douloureux passé ? Dans son remarquable mémoire de fin d’études, Tomáš Bezák, étudiant slovaque en sciences politiques, tire la conclusion suivante : dans les pays où les communistes ont activement participé au processus de transition vers la démocratie, le temps de la gestion du passé communiste est arrivé bien plus tard.
"Dans des pays comme la République tchèque et l’Allemagne de l’Est où, jusqu’à sa chute, le pouvoir communiste a semblé tout-puissant, il n’y eut aucune ‘table ronde’ et le régime est tombé en quelques jours. Il n’y avait aucune raison de promettre quoi que ce soit aux communistes", écrit le politologue tchèque Jacques Rupnik dans son nouveau livre, Une démocratie trop vite fatiguée.
Les régimes communistes hongrois et polonais étaient différents du régime communiste tchèque. Il y avait là un sens à rechercher un accord. Mais il y eut un prix à payer : l’absence d’opérations de lustration et le retour rapide des grandes figures de l’ancien régime aux postes les plus élevés de l’Etat.
Aujourd’hui, l’institution chargée de la gestion du passé communiste en Hongrie est appelée "Commission Kenedi", du nom de son directeur, le sociologue et ancien dissident János Kenedi. Cet homme poursuit avec opiniâtreté deux objectifs : la publication des noms des anciens officiers et agents des services secrets communistes et l’ouverture des archives au public. Mais ce n’est pas simple. "Le ministère de l’Intérieur nous refuse l’accès à une partie des archives, apparemment pour défendre les intérêts de l’actuelle police secrète", explique Kenedi. Et si personne ne sait exactement combien de fichiers ont déjà été détruits, Kenedi prétend que ces documents ont massivement été mis au pilon dans les années 1989-1995.
Il semble donc qu’en Hongrie - à la différence de la Pologne - la classe politique ne souhaite pas, 20 ans après, ouvrir les archives au public. La continuité de la politique, avant et après 1989, y est encore plus marquée qu’en Pologne.
République tchèque et Slovaquie s'en sortent bien
En 2001, lorsque le Parlement slovaque a voté la création de l’Institut de la mémoire de la Nation (UPN) et nommé à sa tête Ján Langoš qui, en tant que député, avait travaillé sur le projet de loi, les politiciens slovaques n’ont pas immédiatement saisi l’importance de cette loi. Il leur a fallu deux ans avant d’en prendre toute la mesure. Entre temps, l’Institut de Langoš avait révélé quantité d’informations, il avait dévoilé sur Internet le registre des dossiers de la StB [la police secrète tchécoslovaque] et son site, victime de l’immense curiosité des internautes slovaques, était tombé en panne à plusieurs reprises.
Si l’on compare le cas de la Slovaquie à celui des autres pays d’Europe centrale, sa gestion du passé communiste fut plutôt une réussite. Grâce à une volonté politique d’affronter le passé et aux opérations de lustration, mais aussi grâce à l’opiniâtreté de Ján Langoš, la politique slovaque s’est purifiée en se débarrassant des anciens espions et agents communistes, et elle n’utilise plus le passé comme une arme politique.
Il semble, par rapport à nos voisins, que nous nous en sortions mieux en République tchèque. Les débats qui accompagnent le fonctionnement de l’Institut tchèque pour l’étude des régimes totalitaires (USTR) sont plus pertinents. Les historiens, les politiciens et les médias ne s’affrontent plus en se demandant s’il convient ou non de rendre public les informations provenant des dossiers des services secrets de l’ancien régime, ils s’interrogent plutôt sur la question de savoir dans quelle mesure nous sommes capables de les interpréter et de les expliquer. Peu à peu, les débats autour de notre histoire communiste passent de la sphère idéologique vers celle de la recherche historique normale.
Dans la salle de recherche, à Prague, n’importe qui peut avoir accès aux fichiers des services secrets. N’importe qui peut identifier la personne qui l’a dénoncé et savoir qui a collaboré avec la police secrète. Le sentiment d’oppression qui règne ici - c’est pour cette raison que les critiques de l’Institut le surnomment parfois "l’Institut George Orwell" - provient justement du fait qu' à eux seuls, les numéros et les procès-verbaux ne suffisent pas à apporter l’explication et la compréhension de ce qui s’est réellement passé.
Notre communauté d’historiens, qui se consacre avant tout aux années 1968 et 1989 est, semble-t-il, encore loin de pouvoir proposer une synthèse des travaux sur notre histoire récente. Mais en dépit de sa courte existence, elle peut se targuer d’avoir déjà obtenu un certain nombre de résultats probants.
République tchèque
Encore une liste révélée sur Internet
En République tchèque, qui été le premier pays d'Europe centrale à rendre publiques les archives secrètes de la Sécurité d'Etat, l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires a un nouveau concurrent. "De nouvelles listes du StB publiées sur Internet", titrait Lidové Noviny le 7 juillet en annonçant la mise en ligne de plusieurs milliers de noms par l'ancien dissident Stanislav Penc. Ce dernier estime que "l'Institut monopolise l’interprétation de l'histoire, dissimule des informations et ne rend publiques que des affaires susceptibles de plaire au plus grand nombre".
Pavel Žáček, le directeur de l'Institut pragois, gère 20 kilomètres de documents et dirige 273 employés. Il estime que Penc ne fait qu’ "enfoncer des portes ouvertes". La nouvelle banque de données est différente de la liste de Cibulka, qui rassemblait les noms des collaborateurs de la police secrète au sein de la population et qui a été largement contestée lors de sa publication en 1992. Lidové Noviny explique qu’elle permettra à chacun de vérifier si, oui ou non, il a fait partie des "personnes surveillées". Mais le quotidien avertit que sur Internet, le profane ne sera peut-être pas en mesure de faire la différence entre un "ennemi" et un "collaborateur" du régime. Alors que l'Institut, parce qu'il peut consulter les originaux des 'registres papier', est capable de "lustrer" chaque nom avec plus de certitudes que le site de Stanislav Penc.
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !