Il y a à peine quelques semaines, les Bulgares pouvaient, en plein été indien, profiter encore de la “vie d’avant”. Les bars et les restaurants étaient ouverts, les boites de nuit aussi, sans parler des centres commerciaux ; les élèves allaient à l’école, les employés à leur bureau. On pouvait voyager partout dans le pays, voire dans quasiment toute l’Union européenne, et les masques n’étaient obligatoires que dans les espaces clos. En comparaison avec d’autres pays européens, il faisait presque bon vivre dans cette Bulgarie-là où, selon les mots du Premier ministre Boïko Borissov, on n’allait pas “enfermer les gens”, où l’économie devait continuer à tourner malgré la pandémie et où la “santé psychique” de la population comptait autant que sa santé physique.
La deuxième vague de Covid-19 était pourtant bien là, avec un nombre sans cesse croissant de personnes infectées, hospitalisées et décédées. Les hôpitaux, débordés, ont commencé à tirer la sonnette d’alarme obligeant les autorités à décréter des mesures plus strictes à partir du 27 novembre : désormais les écoles, universités, bars et restaurants sont fermés ainsi que les grands centres commerciaux.
Mais pour beaucoup, c’était déjà trop tard : en quelques mois à peine, la Bulgarie montrée en exemple de bonne gestion de la première vague, est devenue l’un des pays où, par tête d’habitant, on meurt le plus du Covid-19. “On ne peut pas tricher avec la mort comme avec les institutions européennes”, écrivait le 1er décembre dernier le romancier Guéorgui Gospodinov (auteur notamment de Physique de la mélancolie) dans un texte envoyé aux médias pour dénoncer l’inaction des autorités. “On ne peut pas être premier en tout : en pauvreté, corruption, pollution de l’air, morts sur les routes, théories du complot et ne pas être premiers dans cette pandémie”, poursuivait-il.
Début décembre, la Bulgarie comptait 142 486 cas de coronavirus dont 3 814 morts, avec une moyenne de 4 000 infections et 150 décès quotidiens. A l’échelle de ses 7 millions d’habitants, le pays se classe ainsi en haut du triste palmarès européen du nombre de morts par habitant. Avec l’introduction de ces dernières mesures, qui seront maintenues jusqu’au 21 décembre, les autorités espèrent permettre aux Bulgares de passer les fêtes de fin d’années dans de “bonnes conditions”. Mais suffiront-elles ? Ces derniers jours, les médias locaux ont rapporté des histoires poignantes de personnes âgées décédées chez elles, des patients renvoyés d’hôpital en hôpital en quête de place (et dont deux sont morts sous l’œil des caméras sur les escaliers d’une polyclinique de Plovdiv) et des centaines voire des milliers de membres du corps médical eux-mêmes infectés.
Epuisés et sous-équipés
En première ligne, ces derniers ont dit combien ils étaient à bout, épuisés et sous-équipés face à ce fléau – sans parler de leur faible rémunération. De l’aveu même des autorités, la Bulgarie manque cruellement de personnel médical, une grande partie de ses médecins et personnels infirmiers ayant émigré vers des pays plus riches de l’Union. “On nous accuse de ne pas nous être préparés depuis la première vague au printemps dernier. Mais peut-on raisonnablement remplacer en quelques mois tous ces médecins et infirmiers qui manquent à l’appel ?”, s’est défendu le ministre de la Santé Kostadin Anguelov.
“On ne peut pas être premier en tout : en pauvreté, corruption, pollution de l’air, morts sur les routes, théories du complot et ne pas être premiers dans cette pandémie”.
Guéorgui Gospodinov
Lors de la première vague du Covid-19 la Bulgarie a effectivement été l’un des pays les moins touchés par la pandémie. A la mi-mai, alors que la plupart des pays européens entamaient à peine leur confinement après une crise sanitaire majeure (jusqu’à 600 décès par jour en France), la Bulgarie comptait en tout et pour tout quelque 1 500 cas et une soixantaine de décès. Par quel miracle le pays le plus pauvre de l’UE, au système de santé notoirement défaillant, s’en tirait-il aussi bien ?
Si l’on devait résumer, ce serait un mélange d’un peu de chance, de mesures très strictes prises à temps (et des sanctions sévères pour ceux qui ne les respectaient pas) et une adhésion – du moins à l’époque – franche de la population qui avait très peur de ce nouveau virus, à la politique du gouvernement qui a permis à la Bulgarie de traverser sans trop de dégâts cette première vague. La chance, comme l’a expliqué à l’époque Ventsislav Moutaftchiïski, le médecin militaire à la tête du QG de crise, c’est que la Bulgarie avait décrété une quarantaine avant même que le nouveau virus arrive (fermeture des écoles et mesures de protection spécifiques dans les hôpitaux) à cause de la grippe hivernale qui, tous les ans, fait des ravages dans le pays.
Confinement très strict
Ensuite, cet homme en uniforme de général deux étoiles et au ton martial était l’incarnation de la lutte – toute militaire donc – de la Bulgarie contre le nouveau virus. C’est lui qui a convaincu le Premier ministre d’opter pour un confinement très strict, assorti de mesures dissuasives pour les resquilleurs et un suivi physique, quasi policier, des premiers cas de contamination. Tétanisés par ce qu’ils voyaient sur le petit écran venant d’Europe occidentale, les Bulgares ont joué le jeu, conscients aussi que si des pays aussi développés comme l’Italie, l’Espagne et la France peinaient à ce point à maîtriser l’épidémie, qu’en serait-il de la petite Bulgarie ?
Et puis, les Bulgares ont fini eux-aussi par se “déconfiner” sans vraiment avoir connu le virus, l’été est arrivé avec ses grandes vacances sur les plages de la mer Noire et Égée. Mais faute d’avoir eu de crise sanitaire, la Bulgarie est rentrée alors dans une zone de fortes turbulences politiques, rythmées par des révélations de corruption et de conflits d’intérêts à grande échelle et des manifestations quotidiennes réclamant la démission du gouvernement. Pendant un temps, relativement long, plus personne ne s’est vraiment soucié de ce virus qui semblait de surcroît avoir disparu dans bon nombre de pays d’Europe.
Entretemps, conspirologues et autres adeptes des théories du complot ont prospéré faisant de la Bulgarie l’un des pays les plus atteints par les “fake news” en provenance de l’UE sur la question, selon le docteur Mikhaïl Okoliïski, représentant de l’OMS à Sofia. Plus de la moitié des Bulgares, par exemple, ne comptent pas se vacciner contre ce virus “par peur de se faire implanter une puce”, de se faire “hacker le cerveau” ou d’être “génétiquement modifiés”, explique-t-il aujourd’hui. C’est certainement pour plaire à ce public que le gouvernement actuel a tant tardé à prendre des mesures pour cette deuxième vague. Et, en comparaison avec d’autres pays européens, celles-ci restent relativement souples, voire libérales comme n’a pas manqué de le préciser le général Ventsislav Moutaftchiïski, qui a repris du service – mais cette fois-ci en costume de ville.
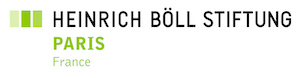
En association avec la Fondation Heinrich Böll – Paris
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !












