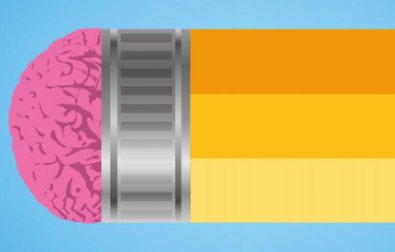Cet article est réservé à nos abonné(e)s

Stephanie Saldaña est une autrice et journaliste américaine qui a passé de nombreuses années à vivre au Moyen-Orient et à s'y documenter. Dans son nouveau livre, What We Remember Will Be Saved (Broadleaf Books, 2023, non traduit en français), elle raconte l'histoire de six migrants ayant quitté leur foyer après la guerre civile en Syrie à travers les objets qu'ils ont emportés avec eux. Dans ce récit profondément humain, Saldaña médite sur la nature de la mémoire humaine et de la préservation culturelle.
Voxeurop : Le livre est sorti il y a environ un an. Que s’est-passé depuis ?
Stephanie Saldaña: C'est un livre qui a pris beaucoup de temps à écrire. Suivre ces histoires et apprendre à connaître ces personnes a été un travail difficile, mais fait avec amour. Et j'étais bien sûr très inquiète à l'idée de rendre justice à leurs histoires. En ce sens, c'était un soulagement de voir ce livre publié, mais même ainsi, j'ai toujours eu un sentiment très protecteur à son égard. Il est sorti le 12 septembre, puis le 7 octobre est arrivé, et le monde a regardé ailleurs. J'espère simplement que c'est un récit auquel les gens reviendront avec le temps. Je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, les gens doivent être conscients des mondes entiers détruits par la guerre et des personnes chargées de transmettre leur histoire. Dans un sens, je pense que ce livre est plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été, même si cela ne semble pas être le cas.
Ce livre traite de la confrontation et de la survie aux traumatismes. Les personnes dont il est question dans votre livre ont les moyens nécessaires pour y parvenir, elles ont beaucoup à offrir et à enseigner aux gens.
Je pense qu’ils portent la charge du souvenir, ces gens sur qui j’ai écrit. On me demande souvent comment je les ai trouvés. C'est plus facile que vous ne le pensez : chaque communauté, chaque famille a ses gardiens de mémoire, et on vous mène toujours à eux. Ces personnes se souviennent, et par là maintiennent l'unité d'une communauté ou d'une famille. Je pense que ce livre traite en réalité de la façon qu’ont ces gens de faire cela.
Vous débutez votre livre en les décrivant comme des "historiens cachés". Nous voyons souvent l'Histoire comme un récit raconté par des universitaires ou des journalistes. Mais votre approche consiste à raconter l'Histoire à travers les récits des gens – les historiens de la guerre.
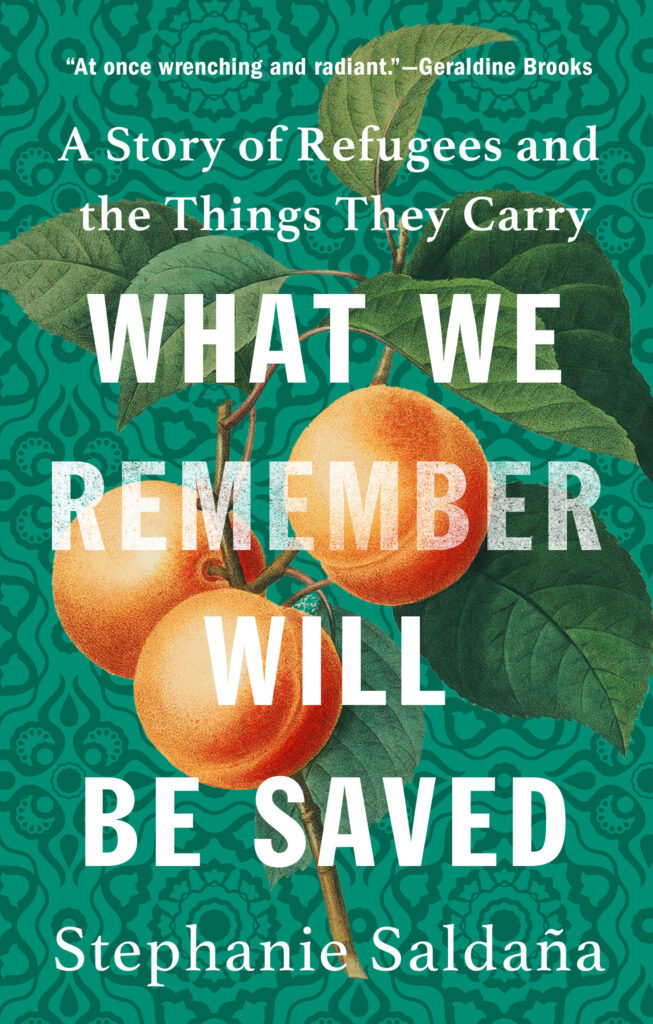
Et je pense que c'est en partie ce qui arrive avec un livre comme celui-ci. Je vivais en Syrie lorsque la guerre a éclaté, et j'ai découvert que le récit qui était fait de la guerre était complètement différent des histoires que les Syriens se racontaient. En tant qu'écrivain, vous ressentez à ce moment-là une sorte d’intuition, vous vous demandez ce qu’il y a entre ces deux versions, pourquoi deux histoires différentes sont racontées. Et vous vous demandez comment partager cette autre histoire qu'ils se racontent tous, qui parle de sauver des choses, de survivre.
Cela a toujours été le défi de ce livre. Lorsqu’il est sorti, je ne voulais pas utiliser le mot "réfugié" dans le sous-titre. Pendant les six années où j'ai écrit ce livre, je n'ai jamais eu l'impression d'écrire à propos de "réfugiés". J'écrivais sur des gens que je connaissais, qui étaient des historiens, des artistes, des musiciens.
Votre livre semble détaché du discours sur les migrants, qui tend à les réduire à une masse sans visage.
Absolument. Je pense également que l'un des problèmes quand on écrit sur les personnes déplacées est que, très souvent, on ne parle que de leur voyage. Elles deviennent ce qui leur est arrivé, en quelque sorte. Je voulais écrire un livre différent, dans lequel les personnes elles-mêmes seraient l'histoire, pour rappeler que chaque personne abrite un monde entier, une histoire entière. Ce n’est pas un livre sur ce qui leur est arrivé, mais sur ce qu’elles sont.
En tant que journalistes, nous essayons de témoigner du monde, mais nous aggravons souvent les choses. Pensez-vous qu'il y a une limite à ce que les journalistes peuvent raconter ?
Je ne sais pas s'il y a une limite à ce que les journalistes peuvent dire, mais je pense que plus nous entendrons les voix des personnes déplacées, plus nous comprendrons vraiment ce qui se passe. Et plus nous refuserons de les écouter, plus nous continuerons à croire à une projection de l'histoire qui n'est pas la réalité.
Montrer les gens nous rappelle également leur humanité.
Les gens m'ont dit des choses horribles, des phrases comme "ce que vous écrivez humanise les réfugiés". Je réponds toujours que non, ils sont tout à fait humains ! Mais ce sont eux qui humanisent les lecteurs qui ont perdu leur humanité. Ou bien on me dit des choses comme "vous donnez une voix à ceux qui n'en ont pas". Et je me demande de quoi ils parlent – [les déplacés] parlent tout le temps ! Nous n'écoutons pas, c'est tout. Nous avons inventé ces phrases pour excuser le fait que nous avons créé des catégories d'humains, ceux qui valent quelque chose et ceux qui valent moins.
Pensez-vous que nous avons perdu notre sensibilité ?
[Les réfugiés de Lesbos] m'ont dit que les [journalistes] venaient, écrivaient sur eux et que rien ne changeait. Alors, à quoi bon ? En tant qu'écrivaine, j'ai certainement des jours où je ressens la même chose. À quoi bon ? Tout cela ne se passe pas en secret. C'est ce qui était choquant à propos de Lesbos : vous lisez des articles à ce sujet et vous pensez à tort que [le camp] est caché au milieu de nulle part. Mais que devons-nous faire quand ces choses arrivent au vu et au su de tout le monde ? J'ai grandi en pensant que le rôle d'un écrivain était de sensibiliser les gens, que si les gens savaient ce qui se passait, alors les choses seraient différentes. Mais quand tout le monde sait, que faire ? Rien ne change. Avec ce livre, je pense que j'ai vraiment eu mes moments de désespoir. Puis, j'ai décidé qu’il était destiné aux personnes qui m'ont raconté ces histoires. C'est pour eux, et c'est tout. Tout ce que d'autres peuvent en retirer, c’est du bonus.
Je suppose que la guerre à Gaza vous a affecté très différemment maintenant que vous avez écrit ce livre ?
Depuis le 7 octobre, lorsque je me renseigne sur la guerre à Gaza et que j'entends parler des maisons détruites, je me rends compte de ce que ça représente, une maison : des années qu'il faut pour économiser l'argent, des objets de leurs anciens villages qui s'y trouvent et qu'ils ne retrouveront jamais, des souvenirs qui y sont attachés ... J'ai toujours pensé que les maisons devraient être considérées comme une forme de patrimoine. Elles renferment tant d’éléments d'une vie. Et quand je vois le nombre de personnes qui ont perdu leur maison – et pas seulement les maisons, mais les dizaines de milliers de vies qui ont été perdues ... Quand vous écrivez un livre comme celui-ci, cela vous met vraiment en face du fait que chaque être humain est un monde entier, et vous vous mettez à voir la perte de vies à une autre échelle.
Chaque personne a une histoire. Chaque maison, chaque arbre, chaque voisin, chaque amitié est une histoire. Je pense simplement à toutes ces pertes, et c'est complètement catastrophique. Nous entendrons ces histoires en temps voulu – oui, nous les entendrons.
Cherchiez-vous quelque chose en particulier lorsque vous avez écrit votre livre ? Dans What We Remember Will Be Saved (“Ce dont nous nous souvenons sera sauvé”), quel est le "What" ?
J'ai longtemps essayé d'éviter d'écrire sur la Syrie. La guerre a commencé en 2011. Je n'ai commencé le livre qu'en 2016. À un moment donné, j'ai su qu'il fallait que j'écrive quelque chose. Et je savais que la seule façon d'y accéder était d’ouvrir le sujet par des choses très petites, c'était tout simplement trop écrasant. J'ai pensé que si j'entrais par quelque chose de petit, ce serait peut-être une porte qui me mènerait à quelque chose de plus grand. J'ai également pensé que je n'oserais jamais demander aux gens ce qu'ils avaient perdu. Mais si je demandais aux gens ce qu'ils avaient sauvé, peut-être commenceraient-ils lentement à parler de ce qu'ils avaient perdu, mais ce serait de leur propre choix. Je pense que le "what" était en fait une interrogation. Je ne savais pas, lorsque je suis partie, si quelque chose serait sauvé. C'était un voyage pour voir, je pense – cela semble stupide de dire cela – si l'espoir était vain.
Je voulais voir si quelque chose – je ne veux même pas utiliser le mot espoir – avait survécu, même si ça avait été dur et douloureux. Quelque chose dont je pourrais parler honnêtement, et qui ne semblerait pas vain. Quelque chose qui ne ressemblerait pas à un mensonge.
Diriez-vous que vous l'avez trouvé ?
Non, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé et m'en ont donné un aperçu.
🤝 Cet article a été produit dans le cadre du projet collaboratif Come Together.
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !