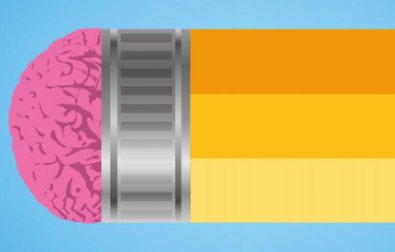Quand mon père est mort, j'ai pris l'avion pour Chișinău et j'ai dormi une nuit dans son appartement. J'ai distribué ses costumes et ses cravates aux voisins. Je n'ai pas touché aux livres. Finalement, je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai allumé la télé. C'était une chaîne russe ; une jeune femme chantait une chanson d'amour, et ça m'a fait tellement peur que j'ai jeté la télécommande et je me suis levée d’un coup. Mon père détestait la langue russe, mon père détestait les Russes.
C’était quelque chose de fondamentalement indécent d’écouter une chanson d'amour russe dans la maison d'un homme aujourd'hui décédé, mais qui, toute sa vie, avait combattu le système soviétique et ne rêvait que d’une seule langue – le roumain. À cet instant, je l'ai vu clairement devant moi : un vieillard plein de regrets, les poings serrés, cette langue étrangère enroulée autour de son cou comme un nœud coulant. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à pleurer, pour tout.
Archipel URSS : le 30e anniversaire de la fin de l’Union soviétique
De l’URSS à Maïdan, un couloir de souvenirs
De l’Union soviétique à la Biélorussie, aller-retour
Union soviétique, l’interminable désintégration
Moldavie: “Etre nés en URSS, c’est un état d’esprit”
En Géorgie soviétique, c’était l’évasion par le foot
Si j'ai quitté l'Union soviétique un jour, c'était cette nuit-là.
J'étais un enfant arrivé sur le tard, mais ce qui s’est toujours tenu entre nous telle une clôture électrique, ce fut plutôt la langue russe. Mon père ne m'a jamais pardonné le fait que, lorsque la Moldavie a proclamé son indépendance, lorsque les Moldaves ont retrouvé en 1989 l'alphabet latin pour lequel ils s’étaient battus, et pour lequel certains avaient même donné leur vie, je n'ai pas fait ce que j'étais censée faire : couper tous les liens avec la Russie. Arrêter de parler russe, de lire le russe, d'avoir des amis russes, voilà ce qu’on attendait de moi.
Je ne dis pas que je n'ai pas essayé, je dis juste que je n’y suis pas parvenue. Il m'était difficile de discuter avec mon père et ses amis, qui n'avaient dû vivre les meilleures années de leur vie qu'à moitié, cachés, dans la peur. Je les ai vus perdre leur santé, leur emploi, leur dignité – tout cela pour le même idéal : la sortie de l'URSS et la réunion avec la Roumanie. Ils m'ont écrasé d'arguments – les grands-parents déportés en Sibérie, la mère née au Goulag, les persécutions. Des vies décimées et des carrières brisées. Qui étais-je après tout, qu’avais-je choisi de représenter ? Je me suis posée la question pendant des années. Pourquoi était-ce si difficile pour moi de haïr, quand la haine était justifiée, qu’elle représentait la bonne voie, celle des patriotes et non celle des traîtres ?
J'ai découvert tout un univers élevé dans une culture étrangère. L’URSS était pareil à un parasite attaquant un arbre avant de devenir l'arbre lui-même
Je me souviens qu'un matin d'automne – ce devait être vers 1991 – tous les enfants de notre immeuble s’en allaient à l'école avec leur sac à dos, comme nous l'avions fait pendant toute notre enfance. Puis, quelqu'un a crié aux garçons d’origine russe “d’aller à la gare et de rentrer dans leur pays, car il n’étaient plus chez eux en Moldavie.” C'était un slogan populaire à l'époque ; on ne l’entendait pas que dans les cours d’immeubles, mais aussi à la télévision et dans la presse. C'est ainsi que la rupture a commencé. Des choses graves s’en sont suivies : des voisins ont cessé de se parler après avoir vécu ensemble en paix pendant des années, des rassemblements, des violences dans la rue, des querelles.
Nous avions enfin eu carte blanche pour dire aux "occupants" que nous ne voulions plus d'eux parmi nous, ou du moins que nous voulions qu’ils fussent de notre côté. L'exemple des pays baltes était notre idéal, mais nous n’avons malheureusement pas réussi à les imiter. On tenait pour acquis que le patriotisme effervescent des Moldaves allait convaincre les Russes d’apprendre le roumain du jour au lendemain. Cela n’est jamais arrivé, et a au contraire conduit à la guerre. La guerre de Transnistrie a commencé un an plus tard et a décimé le pays pour de bon. Une guerre inutile et brutale, une guerre d'égos. À ce jour, la Moldavie n'a toujours pas soutiré la Transnistrie à l'influence russe. La Russie n'a toujours pas retiré ses soldats de cette région, contrairement à ce qu’elle avait promis.
En Moldavie, comme dans la plupart des anciennes républiques soviétiques, des années de renaissance nationale s’en sont suivies. Avec un impact fort notamment dans le domaine culturel, la littérature, le théâtre, la musique, ou le sport . Les écrivains, artistes et athlètes moldaves n'avaient plus à porter le label "soviétique" obligatoire, ils n'avaient plus à passer par le filtre du pouvoir centralisé. La langue roumaine est revenue au pays et, au moins sur le plan idéologique, le lien avec la mère patrie, la Roumanie, a été rétabli.
Il est toujours difficile d'expliquer aux Occidentaux l'enthousiasme que l’on éprouve à pouvoir parler sa langue avec fierté, à pouvoir se présenter avec fierté, mais je persiste à le faire. Je le fais dès que j'en ai l'occasion. Et puis, dans ces moments-là, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement moi qui parle, mais plusieurs personnes qui vivent en moi : la nostalgique, la rebelle, et la revancharde. Puis vinrent les années de transition, qui semblent ne jamais se terminer, et avec elles l'effondrement de l'économie, la dévaluation de l'argent, la traite des êtres humains et la fragilisation des systèmes sociaux. Des années de chômage, de déception, au cours desquelles la Moldavie a constamment fait la une de l'actualité internationale la plus controversée. Ensuite vint le titre de pays le plus pauvre d'Europe et, assez rapidement, le retour officiel des communistes au pouvoir. L'enthousiasme initial a fait place à un scepticisme amer.
Que signifie réellement l'indépendance pour les Moldaves ? Si je devais la résumer en un point, je dirais tout d'abord le droit de choisir. Bien que, en tant que pays pauvre dépourvu de ressources naturelles, ce droit ait toujours signifié celui d'un “grand frère” – la Roumanie, l'Europe, la Russie – il n'est intervenu qu'après la chute de l'URSS. Aujourd'hui, plus d'un million de Moldaves travaillent ou étudient à l'étranger. L’émigration, notamment des plus actifs, est l'une de nos coutumes les plus répandues, et je suis certaine qu’il va bientôt falloir lui trouver une alternative. En même temps, c'est aussi une énorme opportunité pour la jeune génération de trouver sa place dans le monde dans une position différente, avec d’autres aspirations.
En tant qu'écrivain, ce qui m'a le plus tourmenté ces dernières années a toujours été le doute que je ne faisais pas ce qu'il fallait. En ne prenant pas le chemin de l’extrémisme, un chemin que nombre de mes pairs ont pris et par là sont devenus des héros nationaux et des modèles, ai-je le droit moral de parler du passé de ma famille ? Comment puis-je écrire sur les déportations, sur les crimes du régime soviétique, si je continue à parler la langue de ceux qui les ont commis ? M'installer en France a été le pas de côté qui m'a permis de voir les choses sous un autre angle. Pas plus clairement ; juste sous un autre angle.
Arrêter de parler russe, de lire le russe, d'avoir des amis russes, voilà ce qu’on attendait de moi
J'ai aussi fait cette dissection obligatoire que tout enfant né en URSS doit faire tôt ou tard. J'ai découvert tout un univers élevé dans une culture étrangère. L’URSS était pareil à un parasite attaquant un arbre avant de devenir l'arbre lui-même. J’aurais pu l’arracher de moi, mais cela aurait signifié amputer une bonne partie de ma vie. Pour pouvoir aller de l’avant, il fallait que je fasse un choix. En ce qui me concerne, j'ai laissé la haine derrière moi et j’ai séparé la langue russe du régime soviétique auquel elle était liée, les politiciens des gens ordinaires. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, mais c'est fondamental, surtout lorsque vous vous retrouvez parmi des étrangers. Je ne dis pas que j'y suis parvenue, je dis juste que j'ai essayé.
Je ne serai jamais l'une ou l'autre. Je ferai toujours partie de la génération "entre-deux". Celle de personnes élevées entre deux langues et deux identités. Chez moi, partout et nulle part.
À Paris, j'ai une étagère avec quelques livres de mon enfance. Je les garde séparément des autres, et tout le monde à la maison les appelle “les livres de maman”. Non pas parce que c’est moi qui les ai écrits, mais parce que je suis la seule à pouvoir les lire. La langue dans laquelle ils ont été écrits n'existe plus, et ne devrait plus exister. Ils sont écrits en “moldave”, un hybride de mots roumains et d’alphabet russe, une langue inventée par les Soviétiques, qui n'avait qu'un seul but : nous séparer de la Roumanie. Je me sens aussi exactement comme ces livres – seulement à moitié claire, seulement à moitié authentique. Un mélange de ce que je suis et de ce que je devrais être.
Trente ans après l'éclatement de l'Union soviétique, je ne ressens pas grand-chose. Il n'y a pas de date écrite en rouge ou en noir sur le calendrier. Si je n'avais pas été invitée à écrire ce texte, aujourd’hui aurait été un jour comme les autres. Parce que d'une certaine manière, une partie de moi est encore là-bas, même si la carte du monde aujourd’hui dit le contraire. J'ai des amis dans les 15 anciennes républiques soviétiques. Nous échangeons des messages, des paquets, des inquiétudes et des blagues que nous sommes les seuls à pouvoir comprendre. C'est formidable de savoir qu'il existe des personnes auxquelles on n'a pas à expliquer son passé, même si elles viennent d'un autre pays, d'une autre culture.
Tout comme certains sont nés au bord de la mer ou dans les montagnes, nous disons que nous sommes nés en URSS. Il ne s’agit pas d’un lieu, mais d’un état d’esprit. Cela aurait pu être un texte nostalgique. Et peut-être est-ce le cas. J'aurais pu me souvenir des dessins animés muets, des concours scolaires organisés dans les petites cours, des étangs et des eskimos, des lettres sur lesquelles je collais des timbres en les léchant, des innombrables bouteilles que je collectionnais. De l'amitié qui dépasse les frontières. De tous ces petits riens qui ne disparaîtront jamais tout à fait de la vie d’un sovok, un enfant né et qui a grandi en URSS. Mais à côté de cela, à côté de ces souvenirs légers, il y aura toujours pour chacun de nous un prix à payer. J'ai écrit sur le mien. Parce que la façon dont vous choisissez de vous souvenir du passé finit par vous définir en tant qu'être humain.
Cet article est publié en coopération avec la S. Fischer Stiftung et traduit avec le soutien de la Fondation européenne de la culture.
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !