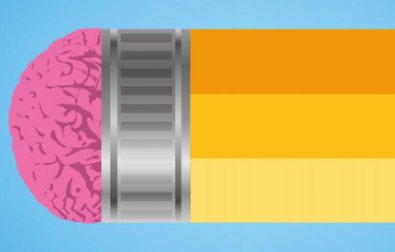Mon père n’a pas un caractère particulièrement sociable. La conversation n’est pas son fort. Il parle peu, et avec retenue. Ce sombre jour de septembre 1990, il n’a même pas ouvert la bouche : il est rentré à la maison après le travail, avant de disparaître silencieusement dans sa chambre.
Prendre conscience que l’un de nos proches est en train de s’effondrer n’est jamais facile. C’est encore plus difficile lorsque cette personne est aussi réservée que mon père. Ingénieur en mécanique, il était à l’époque à la tête du pôle énergie de l’usine Metaliku située près de Gjakova, une ville du sud-ouest du Kosovo proche de la frontière albanaise. Ma mère travaillait également à Gjakova, dans une usine du secteur textile. Cet automne-là, ils ont tous deux été licenciés pour avoir refusé de signer une déclaration de loyauté à la Serbie.
L’Archipel Yougoslavie 30 ans après son éclatement
- Kosovo : Le pays de “bolji život” – la vie meilleure
- Pendant la guerre, sur les lieux du crime, “j’ai vu le pire visage du genre humain” (Serbie)
- Cette horloge de l’apocalypse que je porte en moi depuis la guerre (Bosnie-Herzégovine)
- Nous avions rêvé de démocratie, nous nous sommes réveillés avec le capitalisme (Slovénie)
L’expérience yougoslave ne faisait que commencer lorsque mes parents sont nés. Elle était sur le point d’échouer au moment de ma naissance. Nous avons tous trois vécu ce que les yougoslaves appelaient bolji život: la vie meilleure. Projet réunissant de nombreux peuples des Balkans, la Yougoslavie socialiste a procuré à ses habitants de bonnes conditions de vie pendant des décennies.
Certains groupes ethniques minoritaires tels que les Albanais en ont néanmoins été privés. Mes parents et moi avons pu goûter à l’idylle yougoslave. Si mes parents étaient imprégnés du célèbre slogan popularisé par [le fondateur de la Yougoslavie d'après-guerre] Tito, selon lequel la paix durerait 100 ans, ma génération, au contraire, a vécu en ayant conscience que la guerre pouvait éclater à tout moment. Cette crainte ne s’est pas démentie : la guerre s’est déclenchée maintes fois, sous des formes inédites.
Bolji život n’avait jamais été destinée aux Albanais du Kosovo. Les années 1990 ont d’ailleurs balayé les slogans et les déclarations de fraternité et de paix. Reléguée au rang de lointain souvenir, la solidarité fraternelle a cédé la place à une franche hostilité. Pourtant, curieusement, ce souvenir persiste aujourd’hui : au cœur de la capitale kosovare s’érige le monument de la fraternité et de l’unité, dont l’interprétation a évolué au fil du temps. La gloire des uns fait la honte des autres. Mon fils de 9 ans trouve ce monument tout bonnement hideux et bizarre. De même, les noms de Boro et Ramiz, qui ont longtemps désigné le complexe sportif de Pristina, lui sont complètement étrangers. Lorsque je lui raconte comment l’esprit de fraternité de ces deux héros yougoslaves, l’un serbe et l’autre albanais, est devenu le symbole de l’unité entre ces deux peuples, il ouvre de grands yeux ébahis.
“Bolji život” n’avait jamais été destinée aux Albanais du Kosovo. Les années 90 ont d’ailleurs balayé les slogans et les déclarations de fraternité et de paix. Reléguée au rang de lointain souvenir, la solidarité fraternelle a cédé la place à une franche hostilité.
La monumentale architecture communiste, au caractère presque sacré, continue de faire partie du quotidien ordinaire des habitants, ce qui ne cesse de stupéfier les plus jeunes comme mon fils. Vestiges tangibles du mythe de la fraternité, ces “témoins de pierre” conservent un pouvoir évocateur surprenant. La persistance d’une telle force symbolique peut s’expliquer par les abysses de violence et de désastre dans lesquelles a sombré le mythe yougoslave.
Ce funeste jour de septembre 1990 qui a vu la vie de mes parents s’effondrer comme un château de cartes, s’est également apparenté à une plongée dans les abysses. Il arrive que ma mère évoque la façon dont une vie entière de travail et d’espoir a été détruite du jour au lendemain. Ayant perdu toute perspective de structure et de continuité, mes parents ne s’en sont jamais remis.
Le statut de région autonome de la fédération yougoslave, que le Kosovo détenait depuis 1974, lui a été retiré au printemps 1989. Ainsi, le Kosovo s’est retrouvé soumis aux règles de la police serbe, ce qui a bouleversé la vie de mes parents ainsi que mon enfance. Mener une vie ordinaire est devenu inenvisageable dans un tel état d’urgence. La “vie meilleure” faisait partie du passé.
J’étais alors très jeune, et je n’ai pas immédiatement saisi la gravité de ce bouleversement. Néanmoins, mon quotidien s’est progressivement transformé. Mes parents passaient bien plus de temps à la maison. Notre liberté de mouvement diminuait de jour en jour, tandis que la qualité de notre nourriture se dégradait. Le déclin s’est généralisé, si bien que même la population a diminué : de nombreux Kosovars ont abandonné leur patrie pour fuir en Europe de l’Ouest, ou bien outre-Atlantique. Mon père a longtemps refusé d’envisager l’exil : il resterait fidèle à sa terre natale et ne la quitterait jamais. Bien qu’à peine perceptible d’un point de vue extérieur, son profond sentiment d’appartenance à sa patrie était enraciné dans une histoire familiale mouvementée. Des partisans avaient tué son grand-père, avant que le régime communiste ne ruine son père, le contraignant à déménager dans d’autres villes.
L’état d’urgence et les mesures policières nous ont frappés de plein fouet. Lors de nos traditionnelles réunions familiales du samedi soir, mon père tâchait de préserver une vie de famille aussi normale que possible, malgré les dramatiques évènements en cours. Il se réfugiait dans ses souvenirs de vie étudiante à Zagreb, qu’il considérait comme les meilleures années de sa vie. Il se remémorait également ses voyages en Europe dans les années 70 et 80, à une époque où les Albanais du Kosovo pouvaient voyager librement lorsqu’ils en avaient les moyens.
Ce sont les seules histoires que mon père nous racontait. J’adorais les écouter car elles me révélaient l’origine de son amour. En l’écoutant, je rêvais d’autres vies, d’autres lieux, d’autres mondes, puisque le monde qui existait au-delà des frontières de notre réalité inquiétante restait un mystère. J’ai donc appris à vivre dans mon tout petit monde. Hormis lors d’un unique séjour de vacances dans notre maison d’été d’Ulcinj, sur la côte du Monténégro, nous avons cessé de voyager.
Dans mon imaginaire, ce monde inconnu était d’une grande beauté. Je n’ai jamais osé demander où se situait la frontière. Visibles et invisibles, des frontières se dressaient dans tous les domaines : politique, économique, linguistique, ou encore culturel. Puisque l’autre monde demeurait impénétrable, je suis devenu une éternelle rêveuse.
Même rêver était considéré comme un “crime”. Mais personne ne pouvait m’en empêcher. Mes rêves m’appartenaient. Le rêve de liberté ? Un sublime tissu en soie. Le rêve de soulèvement national ? Un tissu en lambeaux et rapiécé. Mais le Dieu de la Justice de ces rêves était injuste puisque finalement, toutes ces utopies restaient de simples chimères. Aujourd'hui encore, je me souviens de ces rêves, qui me semblaient si tangibles à l'époque, dans les rues où se déroulaient les manifestations. Je rêvais de liberté le long des avenues, sur la place principale, au cœur de foules de milliers de personnes défilant comme des soldats sans drapeau. J’avais confiance en ces grands hommes qui nous appelaient, nous, les enfants, les “petits héros du futur” édifiant la liberté de demain sur les routes du passé.
Dans mon imaginaire, ce monde inconnu était d’une grande beauté. Je n’ai jamais osé demander où se situait la frontière. Visibles et invisibles, des frontières se dressaient dans tous les domaines : politique, économique, linguistique, ou encore culturel.
Descendre dans la rue était un moyen de faire face à la réalité de notre oppression. Là, l’impuissance d’une enfant de dix ans rencontrait le drame national. Ce bouleversement émotionnel fait de révolte, de fierté et de peur, est l’une des expériences les plus marquantes de mon enfance. “Liberté ! Démocratie ! République du Kosovo !”. Mes rêves arboraient ces slogans avant de se briser en mille morceaux lorsque, déçus, nous rentrions chez nous en fin de journée. Dans cette période de confusion, je rêvais de la grande révolution qui instaurerait la paix. À aucun moment, je ne me doutais qu’une enfance vécue dans une période aussi tragique complexifierait et déformerait mon expérience ultérieure de la paix. J’étais une enfant vivant dans un état de guerre permanent, me demandant chaque jour quel nouveau conflit éclaterait le lendemain.
Ces grands rêves demeuraient bien loin de notre quotidien familial. Chez nous, tout allait bien tant que la nourriture ne manquait pas. Après avoir été licenciée, ma mère s’est convertie en femme au foyer, tandis que mon père s’est consacré à l’exploitation d’un petit élevage de poulets sur les terres de mon grand-père. Si le commerce s’avérait possible pendant les périodes les plus calmes, il périclitait dès que les tensions s’accentuaient. Dans ces moments-là, nous avions moins à manger. Notre quiétude domestique dépendait donc directement de la situation politique.
Je me rappelle encore avoir admiré un manteau rouge très à la mode, dans la vitrine d’un grand magasin. Ce devait être en 1993 ou en 1994. Je désirais ce manteau de tout mon cœur. J’ai donc imploré mon père de me l’acheter, en vain. Il répétait invariablement : “nous n’avons pas d’argent”. Cette journée-là fut triste car ce manteau rouge symbolisait tout ce à quoi je ne pouvais accéder. J’aspirais à une vie pleine de couleurs, de parfums, de voyages, et de vraies libertés qui ne soient pas de simples fantasmes. Je convoitais ma propre chambre. Je voulais pouvoir voyager, au lieu de découvrir le monde à la télévision. Je rêvais de mener une vraie vie, alors que je vivais dans une petite maison, dans une petite ville, au cœur d’une période marquée par une longue succession d'événements dévastateurs.
L’Histoire s’apprêtait à tourner une page, devant nos yeux, à une vitesse vertigineuse. En grandissant, je m’étais résignée au vide sidéral, à l’invisibilité des objets de mes désirs, et à l’indifférence qui s’était installée. Une telle vie, habitée par la conscience permanente que tout peut prendre fin du jour au lendemain, peut sembler terrifiante. Néanmoins, nous avons fait preuve d’une étonnante résistance, et d’une capacité d’adaptation remarquable. Dans un monde en perpétuel bouleversement, nous avons appris à protéger nos minuscules havres de paix.
Cette “vie inconstante” était le contraire d’une “vie ordinaire” rythmée par un sentiment de stabilité et de continuité. Vivre au cœur du chaos, sans pouvoir aspirer à une quelconque normalité, a tendance à exacerber les questions existentielles. Lorsque la réalité est constamment construite, puis déconstruite, encore et encore, comme des décors de théâtre qui changent entre chaque scène, surgissent des questions métaphysiques sur le sens de la vie, sur son absurdité, ou encore sur le mystère que recèle la part indéchiffrée de notre code génétique.
Selon certains chercheurs, la transmission des traumatismes psychiques et physiques pourrait relever de l’épigénétique. En laissant des traces sur les gènes des individus affectés, les traumatismes seraient transmis à leurs descendants par le biais de ces modifications génétiques. Mon père a toujours refusé de parler de son traumatisme, et pourtant, son traumatisme est devenu le mien. Il n’a jamais voulu admettre que la réalité pouvait être déformée par le traumatisme. Il n’a jamais évoqué la mort, si ce n’est pour clamer qu’il était temps de la repousser. Le plus loin possible ! Au contraire, j’ai toujours ressenti le besoin de parler de la mort qui a revêtu pour ma génération une tout autre signification. La mort a régné sur nos vies, ouvrant des perspectives complètement différentes. Elle m’a donné une leçon essentielle, quoique très ironique, non pas sur le néant de l’au-delà, mais sur l’abondance de l’instant présent. Mon flirt avec la mort a été artistique et philosophique. Pendant ce temps, certains apprenaient comment mourir. Et d’autres, comment tuer.
Nous sommes en 1998. L’été vient de commencer, le soleil tape fort. Ma mère s’adonne à ses tâches domestiques quotidiennes : cuisiner, nettoyer, laver. Mon père vient de rentrer du marché où il a vendu des œufs en silence, comme absent, accablé par la chaleur. Il est en train de lire le journal quand il annonce : “ça commence”. Ma mère baisse la tête et va dans la cuisine pour faire du café.
Cette “vie inconstante” était le contraire d’une “vie ordinaire” rythmée par un sentiment de stabilité et de continuité. Vivre au cœur du chaos, sans pouvoir aspirer à une quelconque normalité, a tendance à exacerber les questions existentielles.
“Je pars à la guerre. Nous ne nous reverrons peut-être plus jamais”, m’a déclaré quelques jours plus tard mon amie d’enfance. Jolie blonde aux yeux bleus, elle n’avait rien d’une guerrière en apparence. Je la connaissais depuis toujours car elle vivait dans la maison d’à-côté. Nous avions souvent discuté de la révolution, en jouant aux “héroïnes”. La révolution s’offre le luxe de dévorer ses propres fils. Pour les filles, c’est différent. Elles restent derrière la porte, comme un balai prêt à balayer le sol. Cette jeune fille de seize ans, belle et passionnée, s'est échappée une nuit dans l'arrière-pays pour rejoindre l'armée kosovare. Quelques années plus tard, nous avons appris qu'elle s'était suicidée.
Nos chemins se sont séparés cet été-là. Elle est partie, je suis restée. C’est ainsi que l’Histoire façonne des parallèles et des divergences. Si la révolution s’offre parfois le luxe de dévorer ses propres filles sur le champ de bataille, elle ne le fait pas dans les recoins des rêves tels que les miens. Tandis qu’au-dehors se déroulait une véritable tragédie, je me plongeais dans mes livres afin de survivre à cette furie dévastatrice.
La ligne de démarcation entre ceux qui ont fait la révolution et ceux qui ne l’ont que rêvée, se trouvait quelques kilomètres derrière notre maison. Ce que l’on ne peut imaginer ne peut advenir, jusqu’au jour où la réalité s’impose. J’étais protégée par ma propre incapacité à imaginer. Je ne pouvais pas concevoir une guerre si destructrice. L’horreur se cachait derrière les limites de mon imagination.
L’année 1999 a révélé une réalité impitoyable : l’ampleur de la tragédie et l’absurdité de l’existence, de l’Histoire, et du destin. Une véritable descente aux enfers vers une inhumanité absolue. Nous avons découvert la fascination du Mal.
Le soir du 24 mars 1999, mon père et moi écoutions un reportage de BBC News à propos du lancement des bombardements de l’OTAN sur la Serbie, sur un vieux poste de radio qui datait des années étudiantes de mon père. Il était en train de boire du raki. “C’est le début de la fin, a-t-il dit, ils affirment que tout sera bientôt terminé.” Puis, il est retombé dans le silence, l’oreille collée au poste de radio. Je prêtais moi aussi l’oreille, vêtue de mon pyjama jaune, incapable de trouver le sommeil. Cette nuit-là a été la dernière que j’ai passée dans ma maison. Une nuit magnifique, mais sans étoiles.
Nombreux sont ceux qui ont dormi paisiblement cette nuit-là, protégés par l’inimaginable. De nombreux autres avaient déjà été engloutis par l’inimaginable. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, j’ai entendu des voix de femmes dans notre salon. Les femmes de ma ville ont toujours été les premières à répandre les nouvelles. Ce matin-là, complètement désemparées, elles nous ont raconté les atrocités, les meurtres, les viols, et les expulsions perpétrés par les forces militaires et paramilitaires serbes durant la nuit. Ces atrocités allaient se poursuivre sans relâche jusqu’à la mi-juin de cette année en enfer.
L’inimaginable
Notre maison s’est remplie de douzaines de réfugiés. Ce même jour, nous avons déménagé ensemble dans une autre maison. Puis dans une autre, et encore une autre, nomades menacés cherchant à repousser la mort aussi loin que possible. Cette première nuit de bombardements a scindé notre vie en deux : la vie avant, et la vie après l’horreur. L’inimaginable est devenu imaginable et l’est resté. Ces deux parties de nos vies sont séparées par un espace de mémoire où réside l’énigme sur la manière dont nous avons tout perdu du jour au lendemain.
La guerre était terminée mais le pire restait à venir. Les victimes s’étaient endormies au chant des hiboux tandis que les survivants rentraient chez eux. Les morts ne connaissent pas la rancune. Les vivants ont dû apprendre à y renoncer. Ils ont dû apprendre la paix et oublier la guerre.
Pour moi, le pire jour de la guerre a été celui de la libération. Je ne m’étais jamais sentie aussi épuisée. Ma mère a remis la maison en ordre après des mois d’abandon. Mon père est retourné sur les lieux de l’usine où il travaillait, pour voir ce qu’il en restait. Le géant de métal se tenait là, vide et saccagé. J’ai déterré mes livres et mon premier manuscrit de poèmes que j’avais enterrés. La terre les avait conservés comme elle conserve les os des morts. La maison était là, tout était là. Mais nos âmes meurtries ont dû lutter pour reprendre le cours de la vie.
Cet article fait partie du projet Archipelago Yugoslavia, du réseau Traduki. Il est publié en collaboration avec la S. Fischer Stiftung et traduit avec le soutien de la European Cultural Foundation.
Vous appréciez notre travail ?
Contribuez à faire vivre un journalisme européen et multilingue, libre d’accès et sans publicité. Votre don, ponctuel ou mensuel, garantit l’indépendance de notre rédaction. Merci !